Par Jorge Brites.
Du 23 au 26 mai 2019, environ 400 millions de citoyens étaient appelés à voter pour renouveler, pour un mandat de cinq ans, leurs députés au sein du Parlement européen – principale institution démocratique de l’Union européenne. Le moins qu’on puisse dire est que ce scrutin n’a pas passionné les foules, comme l’a d’ailleurs confirmé, in fine et malgré une hausse par rapport à 2014, le taux de participation (50,12% en France, 51% à l’échelle de l'UE). Dans le cadre de la campagne, les différents partis ou mouvements politiques en lice ont pourtant tenté de convaincre les électeurs au fil de nombreux meetings et débats – bien souvent sur la base de promesses impossibles à tenir, puisque ne relevant pas du champ de compétences de l’Union, et encore moins de son parlement. Ainsi, le 9 avril, les principales têtes de liste étaient réunies sur le plateau de RFI et France 24 pour débattre. Première question des journalistes : « Est-ce que l’Union européenne, c’est bon pour la croissance aujourd’hui ? »

Question étonnante lorsqu’on se rappelle que le cœur du projet européen repose, aujourd’hui et avant toute chose, sur la construction du Marché Unique, et donc sur une certaine vision de l’économie politique. Et question d’autant plus étonnante qu’elle est posée comme si la croissance était un objectif qui allait de soi, une finalité évidente qu’il faut rechercher à tout prix. Et ce à une époque où, basée sur la dégradation alarmante de nos ressources, la réflexion se porte au contraire sur la nécessité de revoir nos principaux paradigmes pour s’orienter vers des modèles moins productivistes.
Pour se libérer de cette obsession de la croissance, une question plus pertinente serait : l’Union européenne est-elle le cadre pertinent pour penser l’avenir et assurer notre prospérité ?
Arrêtons-nous un instant sur la notion même de croissance, qui encore aujourd’hui, contre le bon sens, revient comme une évidence à la bouche de notre classe politique et médiatique. Tout récemment, le 6 mai 2019, était rendu public le rapport de la plateforme des Experts pour la biodiversité et les écosystèmes (IPBES) – un organisme de l'ONU composé d’écologues et de spécialistes des écosystèmes, mais également de nombreux économistes et sociologues. Sans détour, ce rapport affirme que « l’Humanité doit changer profondément sa manière d’exploiter la nature ». Leur propos s’appuie sur près de 15 000 articles scientifiques et rapports internationaux revus par 145 scientifiques, et confirme tous les constats dramatiques déjà produits par le Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) au niveau de l’ONU. Le fait qu’un million d’espèces animales et végétales soient aujourd’hui menacées d’extinction n’est que le signe le plus flagrant d’une dégradation (voire d’une destruction pure et simple) de tous les écosystèmes de la planète du fait de la seule activité humaine. Par contrecoup, de nombreux « services » que nous rend la nature sont en déclin ; ainsi, les capacités de la Terre à nous fournir de la nourriture, de l’eau pure, un air sain, des fibres (coton, lin, laine, bois), des matériaux de construction, s’affaiblissent.
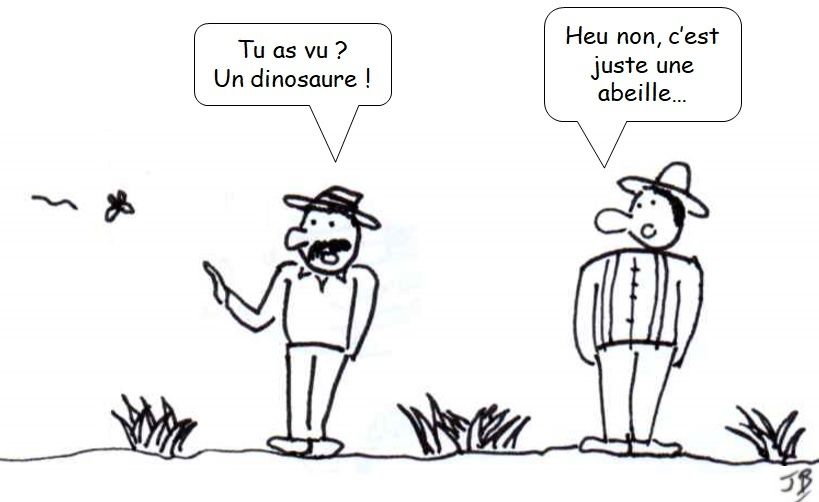
Issu de plus de trois ans de travaux, le texte précise : « Les objectifs pour conserver et avoir une utilisation durable de la nature ne peuvent pas être atteints selon les trajectoires actuelles et les objectifs à 2030 et au-delà ne pourront être remplis qu’à travers des changements politiques, sociaux, économiques et technologiques profonds ». Ces affirmations ne sont pas une vue de l’esprit, une vague théorie ou un pari sur l’avenir. Elles sont la conclusion logique d’une situation dont n’importe qui peut, déjà depuis plusieurs années, constater les effets autour de lui : disparition des insectes, multiplication des scandales concernant la qualité de l'alimentation d’origine animale, dérèglement des saisons, multiplication des catastrophes climatiques (tempêtes, sécheresses, inondations, etc.), montée du niveau de la mer qui menace déjà certaines côtes et des îles entières, présence massive de déchets plastiques dans les océans et les fleuves, dégradation des sols cultivables, etc.
Le défi de changer de grille de lecture pour abandonner le dogme de la croissance
On comprend bien que ce constat ne pose pas seulement la question d’une réorientation à la marge de nos modes de vie. Il rend indispensable un changement radical de notre modèle de société dans son ensemble : nos modes de production et de consommation, nos sources d’énergie, notre alimentation, notre mobilité, notre vision du monde animal, végétal et minéral, du vivant et du non-vivant. Il s’agit d’une véritable question de survie, puisqu’une « Sixième phase d’extinction des espèces » est évoquée (et avérée) depuis quelques années déjà. Le 10 mai dernier correspondait d'ailleurs au « jour du dépassement » pour les Européens – soit le jour où, si tout le monde vivait comme nous, nous aurions épuisé les ressources que procure en une année la Terre. Rappelons qu'en 1961, il y a presque 60 ans, ce « jour du dépassement » européen était le 13 octobre, soit cinq mois plus tard. Si l'ensemble de l'humanité consommait comme les Européens, il nous faudrait l'équivalent de 2,8 planètes Terre. Cela signifie que pour les huit prochains mois, nous allons vivre « à crédit » (ce qui devrait parler à des gens obsédés par la question de la dette) par rapport à d'autres pays et par rapport aux générations futures. Si nous continuons dans ce modèle, nous allons inévitablement dans le mur. Or, dans un tel contexte de raréfaction et de dégradation des ressources, et si l’on ajoute que la population mondiale continue d’augmenter de manière significative, difficile de concevoir que l’on maintienne contre vents et marées (littéralement) le sacro-saint objectif de croissance économique – qui, dans le système tel qu’il est, implique une augmentation aveugle de la production et de la consommation, et donc de poursuivre l’extraction abusive de ressources (pour l'essentiel non renouvelables).

La difficulté de sortir des logiques productiviste et consumériste constitue un défi culturel et philosophique pour nos sociétés (La société de consommation en Europe : chronique d’une construction socioculturelle sans issue durable). Elle impliquerait en effet de remettre en question tous les paradigmes qui ont forgé nos modes de vie depuis la Révolution industrielle du XIXème – avec une accélération lors des Trente Glorieuses –, et qui ont assuré une relative prospérité et un accès au confort matériel (au moins en apparence) pour des générations d’Américains, d’Européens puis d’Asiatiques. Surtout, ce défi implique une remise en question, par nos élites politiques, économiques et culturelles, de tout le modèle de société qui leur a permis de se retrouver en haut de la pyramide sociale – en plus de s’enrichir personnellement. Difficile d’imaginer que ces mêmes élites engageront de leur propre chef les changements nécessaires. D’autant que repenser le modèle autrement contreviendrait à leur vision du monde (selon laquelle une situation ne devient urgente que quand elle les menace directement), à leur éducation, à leur instruction académique et idéologique, et (plus important) à leurs intérêts politiques et financiers.
Même le contexte international ne se prête pas à un changement, à tête reposée, de notre modèle de société. De nouvelles puissances ont rejoint la même course à l’économie de marché et accusent des taux de croissance à deux chiffres, menaçant les intérêts des pays les plus pollueurs et revendiquant leur droit à exploiter eux aussi la planète et ses ressources. En outre, l’économie mondiale n’a jamais produit autant de richesses (même si celles-ci n’ont jamais été aussi mal réparties), permettant l’émergence d’une élite financière qui ne demande qu’à continuer de s’enrichir – rappelons que le monde n’a jamais compté (en US dollars) autant de millionnaires (53 millions de personnes en 2019, d’après une estimation du Crédit Suisse) et de milliardaires (2 208 personnes en 2018, d’après le magazine économique américain Forbes).

Parallèlement, les crises politiques et sociales se multiplient (Printemps arabe, multiplication des conflits et des flux migratoires, montée des populismes teintés de racisme en Occident, en Asie et en Amérique latine, etc.), rendant très incertaine et risquée (pour les élites) l’issue d’une réforme profonde de notre économie et de notre système politique et social. Dans son essai Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition et de leur survie (2005), le géographe et biologiste américain Jared Diamond analyse plusieurs cas de sociétés humaines disparues suite à la surexploitation de leurs ressources. Sur cette base, il explique très clairement comment le refus des élites à changer les valeurs dominantes et à engager une modification des modes de vie peut constituer un facteur décisif d’effondrement d’une société. Et cela de façon d’autant plus spectaculaire que la plupart des exemples étudiés, tels que l’île de Pâques ou la civilisation maya, ont connu un effondrement rapide juste après leur âge d’or. La raison en est que la période de surexploitation des ressources donne une illusion de « prospérité » qui n'invite pas les peuples concernés à la mesure, et rend d'autant plus surprenant (et rapide) le collapse. La dégradation des ressources provoque généralement des conflits internes pour leur exploitation et, au moindre changement climatique brutal, des menaces de famine sur les classes sociales les plus pauvres (les changements climatiques étant favorisés eux-mêmes par la surexploitation des sols et des forêts). Les élites, soucieuses de maintenir leur aura politique et de préserver leurs intérêts économiques à court terme, affirment qu’il faut aller plus loin dans les pratiques qui ont pourtant amené à surexploiter les ressources (par exemple, l’édification de statues géantes sur l’île de Pâques pour satisfaire les Dieux, dont dépendrait la fertilité de la terre, ou encore la construction de sites religieux monumentaux dans les cités mayas). Et comme les élites bénéficient des avantages sociaux liés à leur position, ils ne saisissent pas l’urgence de la situation et retardent des réformes pourtant nécessaires… ce qui ne leur permet nullement d’échapper à la catastrophe. Ils ont à peine le privilège d’être les derniers à mourir. Ce cercle vicieux aboutit inévitablement à des révoltes et à un effondrement total ou partiel de la société.
Représentation de la dynastie dirigeante durant l'âge d'or de la civilisation maya, sur le site archéologique maya de Copán (Honduras).
L’Histoire de répète. Elle ne le ferait pas en vain si l’être humain savait en retenir les leçons. Si comparaison n’est pas raison, il apparaît toutefois clairement que la surexploitation depuis des décennies (voire des siècles) des ressources de pays africains, asiatiques et latino-américains, au profit de pays occidentaux et de quelques nations asiatiques, crée le même cercle vicieux. Les écosystèmes y sont dégradés, y compris les sols, les mers et les fleuves – cas illustratif, on parle de « septième continent » pour évoquer la concentration de plastiques observée dans l'océan Pacifique, dont la surface équivaudrait à trois fois celle de l'Hexagone. Le climat en est fortement altéré. Une instabilité sociale et politique en découle, poussant des millions d’individus à migrer vers des zones de concentration de richesse, au Sud comme dans les pays occidentaux. Le Nord, lui, réagit en fermant ses frontières – avec l'illusion qu’il pourra ainsi échapper à l’effondrement ou à ses échos (Relations Nord-Sud : quand la collapsologie bouleverse une lecture dépassée).
L’Union européenne et le mythe du marché libre et non faussé
La question n’est donc pas de savoir quel cadre nous permettra le mieux, demain, de produire encore plus de croissance. Chercher à répondre à cette question reviendrait à se demander comment traverser le mur qui se présente sur notre route. Et l’absence de vision de nos élites ne peut être uniquement compensée par les initiatives locales et individuelles (« Îlots d’innovation » : quand le citoyen a un temps d’avance sur la classe politique). Il faut un changement global et politique. La bonne question serait donc plutôt : l’Union européenne est-elle le cadre pertinent pour repenser un modèle qui soit durable ? Pour penser l’avenir et notre prospérité dans le respect d’une planète déjà fortement dégradée ?
L’Union européenne constitue un espace de libre-échange et de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Il est aisé de comprendre les avantages que peuvent tirer d’un tel espace les acteurs économiques européens. Un vendeur de cuillères slovaques qui accède à un marché de près de 500 millions de consommateurs voit évidemment ses opportunités d’augmenter son chiffre d’affaires exploser. Sauf qu’il faut tenir compte que cette même entreprise fait concurrence, une fois sur le marché, à des entreprises françaises, belges ou danoises qui sont soumises à des obligations salariales plus lourdes. La création du marché unique européen a donc un travers évident, puisqu’il supprime toute barrière douanière interne à l’Union tout en se voulant le lieu d’une « concurrence libre et non faussée » : celui de donner un avantage compétitif aux entreprises les moins-disantes en matière sociale. On en a vu l’une des conséquences avec la polémique qui traîne depuis près de quinze ans concernant le régime des travailleurs détachés au sein de l’Union européenne, et dont tout le monde s’accorde à dire qu’il n’est pas satisfaisant et que la fraude constitue aujourd’hui la règle.
Inspirée par les économistes libéraux de l'école de Chicago, les pays membres de l'Union européenne, inspirés par les gouvernements de Margaret Thatcher (1979-1990) au Royaume-Uni et de Ronald Reagan (1981-1989) aux États-Unis, ont mis en œuvre des programmes de réduction des dépenses et d'ouverture du capital des entreprises publiques. En vendant ce capital, les autorités ont abandonné d'incontestables leviers d'intervention économique. L’État français a ainsi cédé environ 1 500 sociétés et transféré plus d'un million de salariés au secteur privé depuis 1986 et les premières privatisations lancées par Jacques Chirac (alors Premier ministre). La part de l'emploi public dans l'emploi salarié total, hors fonction publique (enseignement, administration, hôpitaux...), est passée de 10,5% à 3,1% en trente ans.
La politique de la concurrence a été essentielle pour la réalisation du marché intérieur. Si la raison d'être de ce dernier était de permettre aux entreprises de se concurrencer à conditions égales sur les marchés de tous les États membres, celle de la politique de la concurrence était quant à elle de favoriser l'efficience économique en créant un climat propice à l'innovation et au progrès technique, pour le plus grand bonheur des consommateurs. L’idée sous-jacente est que dans le cadre de l'économie de marché, la concurrence soutiendrait la réussite économique, à la fois en protégeant au mieux les intérêts des consommateurs européens et en assurant la compétitivité des entreprises, des produits et des services de l'Europe sur le marché mondial. La politique européenne de la concurrence permettrait aussi d'éviter que d'éventuelles ententes et pratiques anticoncurrentielles, de la part des sociétés ou des autorités nationales, n'entravent une saine dynamique de concurrence (ententes et pratiques concertées, abus de position dominante, monopoles, etc.).
Force est de constater que le cercle vertueux de la concurrence n’est pas au rendez-vous. Dans les dix dernières années, le Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Union européenne est passé de 15 000 milliards à 17 000 milliards d'euros ; on a donc produit 2 000 milliards d’euros de richesses supplémentaires. Sauf que pendant la même période, les prix de la plupart des produits de première nécessité ont augmenté (conséquemment au passage à l’euro, et même après), le taux de travailleurs pauvres est passé de 7% à 10%, et le taux de chômage a globalement augmenté, notamment depuis la crise de 2008. On comprend bien que dans ces conditions, les gens qui travaillent et produisent de la richesse ne peuvent considérer avec satisfaction le marché unique européen (et la croissance économique que celui-ci a permise), puisqu’il va de pair avec une précarisation de leurs conditions de travail et de leur niveau de vie.
En outre, plusieurs projets industriels ambitieux, relatifs à l’aérospatial (Ariane), à l’aéronautique (Airbus, Concorde), à la géolocalisation par satellites (Galileo) ou encore à l’énergie (EPR, ou réacteur pressurisé européen) ont été lancés au cours des dernières décennies avec parfois un franc succès. Or, loin de tout esprit de concurrence intra-européenne, ils ont émergé grâce à une logique de coopération communautaire ou intergouvernementale qui ne peut se passer de l'initiative publique, et donc qui fait fi de l'objectif de concurrence libre et non-faussée.
L’absence de vision économique partagée
Aujourd'hui les États membres de l'Union n'ont pas une vision commune de ce que doit être une politique industrielle européenne. La notion même reste contestée par de nombreux États membres : les pays dont l'économie est dominée par les services ou les technologies de l'information (l’Irlande, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Autriche et, dans une certaine mesure, les Pays-Bas et la Suède) contestent la pertinence de toute politique tendant à préserver la compétitivité des secteurs traditionnels intensifs en main d'œuvre. Ils considèrent que toute action en ce sens s'apparente à du protectionnisme, et que, dans l'avenir, seuls les secteurs de haute technologie sont appelés à créer de la valeur sur notre continent. Les pays d'inspiration très libérale (les mêmes, plus le Royaume-Uni et certains nouveaux membres) professent qu'à elles seules, les politiques fondées sur l'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la concurrence suffisent à créer un climat de compétitivité – qui est presque devenu un objectif en soi, en aucun cas un principe avec des ambitions de développement et de solidarité.
Toute intervention publique reste aujourd’hui subordonnée au respect des règles de concurrence établies par le Traité instituant la Communauté européenne. Une logique qui laisse perplexe, puisque tout en favorisant la concurrence, au sein du marché unique, entre les acteurs économiques nationaux, l’Union s’expose à celle des puissances économiques externes. À demeurer sur une vision fondamentaliste de la concurrence, l’UE s'est donc elle-même handicapée face aux autres pays industrialisés (États-Unis et Chine en tête) qui mènent tous des politiques interventionnistes et soutiennent par tous les moyens leurs entreprises dans la conquête de marchés stratégiques. Un exemple illustratif, en 2008, lorsqu'il avait été question de la levée des quotas d'importation du textile chinois : l'échéance était connue de tous depuis dix ans mais aucune mesure significative d'accompagnement du secteur n'avait été mise en place (ni par la Commission européenne, ni par les États membres). Les entreprises ont dû, seules, se préparer à l'ouverture du marché européen. Un rééquilibrage des politiques européennes de la concurrence, commerciale et industrielle serait donc nécessaire pour protéger nos emplois et défendre une industrie locale. En outre, alors que la question de penser un modèle économique durable se pose, il serait également temps de mettre sur la table le principe même du libre-échange commercial, c'est-à-dire d'ouvrir des secteurs stratégiques (comme le textile) à la concurrence internationale, compte tenu entre autres du coût « environnemental » du transport des biens et des services concernés.
Aujourd'hui, l'exécutif communautaire semble plutôt en mal d'inspiration. La Stratégie de Lisbonne, définie pour la décennie 2000-2010 afin de planifier les orientations économiques de l'Union vers l'innovation et des investissements d'avenir, a été un échec. En revanche, la situation de « guerre économique » créée par la logique de concurrence s’est doublée d'une « guerre sociale » avec la montée en puissance des pays à bas coût de main d'œuvre. À laquelle il convient d’ajouter un recul général des services publics, conforme aux politiques de rigueur budgétaire mises en place par la plupart des États membres, pour respecter le Pacte de Stabilité Budgétaire qui fixe à 3% du PIB le déficit autorisé. Tout cela nuit gravement à l’image de l’Union européenne, restreint considérablement la marge de manœuvre des acteurs publics pour investir dans le progrès technologique et dans la transition écologique (qui demanderait des moyens importants), et contribue à une dégradation continue du niveau de vie des citoyens et à un accroissement des inégalités – puisque les services publics sont un outil de solidarité nationale, et qu’ils s’ouvrent progressivement à la concurrence pour entrer dans une logique de rentabilité et de profitabilité.

Ouvrir les yeux sur l’urgence climatique et environnementale, pour garantir notre prospérité demain
Les dernières décennies ont apporté à elles seules la démonstration que la croissance n’implique pas nécessairement une réduction des inégalités sociales, ni une amélioration du niveau de vie. Au mieux, elle donne le sentiment de laisser de côté une partie de la population tout en préservant le niveau de vie d’une classe moyenne supérieure bien intégrée à la mondialisation, et tout en permettant aux plus fortunés de poursuivre leur accumulation de capital – un sentiment qu’exprime depuis plusieurs mois le mouvement des Gilets jaunes en France (Gilets jaunes : jacquerie de beaufs « réfractaires au changement » ou révolte de la « France périphérique » ?). Se maintenir coûte que coûte dans une logique de croissance va donc à l'encontre du bon sens et s’appuie sur une lecture erronée de l’économie, voire à une négation du réel.
Surtout, compte tenu des nombreuses crises qui se profilent en raison des changements climatiques et de la surexploitation de nos ressources, c’est tout simplement absurde. L’Union européenne apparaitrait comme un cadre idéal pour assurer notre prospérité future et repenser l’avenir, si la Commission européenne et les États membres définissaient, ensemble et de façon cohérente, un vaste plan pluriannuel de transformation radicale de notre économie, impliquant des investissements dans le capital humain et dans des industries cohérentes avec le concept de durabilité. Pour cela, il faudrait penser une économie globale qui intègre systématiquement les concepts d’économie circulaire, de biomimétisme, d’économie de la connaissance, de recyclage et de récupération, de lutte contre les gaspillages et de juste définition des besoins (voire de frugalité), de respect de la nature et de la vie animale et végétale. Nul besoin d’un doctorat en économie pour deviner le potentiel colossal en création d’emplois de qualité que représenterait une planification ambitieuse, associant acteurs publics et privés à l’échelle de l’Union européenne, pour refonder nos modes de production et de consommation et notre mobilité au jour le jour, l’aménagement urbain et rural, nos sources d’énergie, notre système de solidarité, notre éducation, etc.

La tâche paraît immense, mais elle semblerait un moindre mal si conscience était prise des changements qu’impliqueront, à l’inverse, le statu quo dû à une inaction politique. Très justement, le 6 février dernier, le comédien et militant écologiste Brice Montagne interpellait les députés luxembourgeois dans leur Parlement : « Il est nécessaire, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, d’opérer un changement systémique, un changement radical de société. L’essayiste Naomi Klein [journaliste et altermondialiste canado-américaine] a rappelé dans son livre Capitalisme et Changement climatique que lorsqu’il a fallu faire face à l’Allemagne nazie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et la Russie aussi, ont opéré une réorientation complète de leur économie en l’espace de quelques mois, parce qu’ils étaient dans un état de crise. Pour comprendre l’état de crise dans lequel nous sommes aujourd’hui, hélas, nous avons un énorme problème : nous n’avons pas d’ennemis autres que nous-mêmes en face de nous. Nous n’avons pas un visage sur lequel projeter notre haine pour pouvoir déclencher notre motivation. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous baser pour pouvoir nous mettre dans l’état d’urgence qui est nécessaire, c’est un positionnement philosophique – d’ouverture à l’autre, d’extension du domaine du "nous" (le "nous" auquel on prête attention et auquel on étend sa solidarité), et la connaissance scientifique […] de ce à quoi nous avons affaire. Le rapport du GIEC qui a été publié en automne 2018 détaille tout ce que nous devons faire et tout ce à quoi nous avons affaire. […] Ne pas lire ce rapport à l’heure actuelle, qui fait 32 pages – 32 pages le rapport destiné aux politiques ! –, ça vous empêche d’avoir cette connaissance. Ça vous empêche de faire avancer l’état de crise dans lequel nous devons entrer, parce que la crise est déjà là, mais la réaction politique, elle, non. […] Cette assemblée peut tout à fait, dès demain – vous avez la nuit pour lire le rapport –, déclarer l’état d’urgence climatique. Le Luxembourg peut porter ce sujet au Conseil européen et refuser d’aborder tout autre point à l’agenda tant que l’état d’urgence climatique au niveau européen n’est pas déclaré. Vous avez ce pouvoir, vous avez une voix au Conseil européen. Mais pour ça, il faut s’ancrer dans la connaissance du réel. Dans le combat que nous menons, nous n’avons pas d’autres choix ». Plus que de moyens, la réaction dépendra de la volonté politique, et donc d’une prise de conscience de nos élites dirigeantes – qui risque de n’arriver que lorsque nos sociétés seront au pied du mur.

On notera toutefois que le Royaume-Uni a tout récemment, comme une petite lueur d’espoir en écho à ce discours, voté « l’urgence écologique et climatique ». C’est sur proposition du Parti travailliste que les membres de la Chambre des communes ont adopté le 1er mai 2019 un texte en ce sens. Ce vote intervenait à l’issue de onze jours d’occupation de points névralgiques de la capitale et d’autres actions de désobéissance civile menées par le mouvement Extinction Rebellion au cours du mois d’avril – telles que le blocage du Musée d’Histoire naturelle de Londres. Jeremy Corbyn, actuel leader du Parti travailliste, déclarait à cette occasion qu’« en devenant le premier parlement à déclarer l’urgence climatique, nous pouvons déclencher une vague d’actions venues des parlements et gouvernements du monde entier ». En attendant, cette séquence, comme tant d’autres, reste essentiellement symbolique, puisque le texte n’a pas valeur contraignante sur la politique gouvernementale. L’exécutif britannique n’a d’ailleurs pris aucun nouvel engagement suite à ce vote.
Surtout, on observe qu’en Europe, la tendance n’est pas à l’écologisme partout, et que des institutions conservatrices et des lobbys suffisent à bloquer toute mesure coercitive. Ainsi, dès le lendemain du vote britannique précédemment mentionné, le 2 mai, le Sénat français rejetait en première lecture une proposition de loi du groupe socialiste visant à introduire l’incrimination d’« écocide » dans le Code pénal français afin de « punir les crimes environnementaux d’une particulière gravité ». L’écocide y était défini comme le fait de « porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre ». Des sanctions dissuasives étaient même prévues : une peine de réclusion criminelle de vingt ans, une amende de 7,5 millions d’euros ainsi que l’imprescriptibilité, comme elle est déjà prévue par le code de procédure pénale pour les génocides et les crimes contre l’humanité. Si le texte et l’initiative du groupe socialiste se sont vu reprocher un certain amateurisme et un manque de clarté sur certains points (par exemple s’agissant du caractère intentionnel ou non des infractions visées), il reste que l’initiative a eu le mérite de poser le débat. Le gouvernement a préféré argumenter sur l’idée que ce sujet était plutôt du ressort du droit international (souvent moins contraignant et moins réactif).

La nécessité de changer le personnel politique et de renforcer la démocratie
Au sein des États membres comme de l’Union européenne, l’idée d’Europe est bradée depuis déjà plusieurs années sur l’autel du libéralisme économique (Le projet européen : agir pour convaincre, et non convaincre que l’on agit). Cette stratégie sert des intérêts particuliers, mais elle s’appuie également sur l’idée que le libre-échange serait pacificateur et facteur d’innovation et de prospérité – les acteurs économiques étant rationnels sur le marché, et la « Main invisible » faisant le reste, grosso modo. Pourtant, en contribuant à la surexploitation des ressources et à l’accroissement d’une concurrence « sociale » entre travailleurs, le marché unique accroît les tensions, et ne saurait évidemment être qualifié de « pacificateur » (L'adage « L'Europe, c'est la paix » est-il toujours d'actualité ?). De même que la mainmise des pouvoirs publics sur l’économie n’est pas un frein à l’innovation technologique, comme l’attestent plusieurs projets industriels déjà évoqués ici (Airbus, Galileo, EPR, etc.). Le groupe Engie, dont le gouvernement français vient tout récemment de voter la privatisation (dans le cadre de la Loi Pacte) en est une belle démonstration : à capitaux publics, il constitue le troisième groupe industriel mondial spécialisé dans l’énergie. Et on aurait pu prendre bien d’autres exemples d’entreprises publiques qui étaient largement bénéficiaires au moment où l’État en a ouvert le capital à la privatisation. Au contraire, cette place de l’État dans des secteurs clés de l’économie constitue une garantie de souveraineté nationale et permet une certaine marge de manœuvre pour être en mesure, demain, d’engager des transformations radicales dans la société.
Tout n'est pas à jeter, et force est de constater que le Parlement européen a même parfois un temps d'avance sur les États sur le plan environnemental. On peut citer comme exemple le vote, à une large majorité le 27 mars dernier, mettant fin aux produits en plastique à usage unique. Une dizaine de catégories de produits, comprenant les cotons-tiges, les couverts, les assiettes ou encore les bâtonnets pour ballons, sera interdite à partir de 2021, s'il existe des alternatives – les catégories de produits concernées représentent tout de même, à elles-seules, 70% des déchets échoués dans les océans et sur les plages. Pour d'autres produits, notamment les emballages en plastique pour des aliments prêts à consommer, l'objectif est de réduire leur utilisation au niveau national et d'être plus exigeant sur leur conception et leur étiquetage. L'Union européenne souhaiterait également mettre les fabricants de tous ces produits à contribution, avec une application renforcée du principe pollueur-payeur, et établir un objectif de 25% de contenus recyclés dans la fabrication de bouteilles en plastique d'ici 2025, et de 30% d'ici 2030. Si cette décision des eurodéputés n'est pas juste l'illustration de leur altruisme et de leur avant-gardisme (elle est avant tout le résultat du choix de la Chine de fermer son territoire, désormais, au stockage des déchets européens), incontestablement, les institutions communautaires – en tête desquelles le Parlement – ont fait la démonstration qu'elles pouvaient aller dans le bon sens.
Pour autant, elles demeurent sur une logique de « petits pas » encore insuffisants (sans doute, en partie, en raison de puissants lobbys financiers et de la diversité des opinions à prendre en compte parmi les États membres). Peut-être aussi parce qu'un changement de cap global et profond ne peut pas être décidé seulement par le Parlement européen, ni même par la Commission ; à un tel niveau de décisions, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui sont en cause. En outre, les investissements qui seraient nécessaires pour que l'Europe amorce une franche transition écologique semblent clairement en contradiction avec l'esprit des traités européens, de la Commission européenne et de la Banque Centrale Européenne, qui prônent des politiques de rigueur budgétaire et des stratégies économiques concurrentielles dont la conséquence principale est d’affaiblir les États (sans pour autant augmenter les moyens de l'Union).

C'est pour cela qu'aujourd'hui, compte tenu des lignes idéologiques et des certitudes qui guident les institutions communautaires, l'Union européenne – c'est une observation empirique, qui contredit l'intuition qui voudrait que l'échelle supranationale soit plus pertinente pour traiter de problèmes qui font fi des frontières – ne saurait constituer le cadre pertinent pour repenser l’avenir. Car il conviendrait que les pouvoirs publics reprennent un rôle d’impulsion, et l’Union européenne y constitue manifestement un obstacle. Le cadre européen serait idéal parce que l’échelle est bien plus impressionnante et à la mesure du défi qui nous est posé. Le GIEC ou d'autres acteurs, scientifiques ou militants écologistes, font des recommandations régulières et proposent des solutions concrètes applicables au niveau de l'Union dans son ensemble. On peut citer le World Wildlife Fund (WWF), qui préconise de viser zéro émission carbone d'ici à 2040, de mieux contrôler la pêche, de consacrer 50% du budget européen aux énergies renouvelables, ou encore de mettre en place une nouvelle Politique Agricole Commune. Mais il faut compter avec une multiplicité d’acteurs, dont la plupart des têtes pensantes raisonnent encore suivant des schémas dépassés, quand ils ne rejettent pas carrément toute idée de transformation écologique, par intérêt ou par idéologie. D'ailleurs, certains pays ou régions d'Europe se sont déjà engagés vers une transition énergétique solide, tels que l'Écosse ou le Portugal, mais sans effet domino sur l'ensemble de la communauté.
L’instruction académique de nos élites politiques et économiques, au niveau des États membres et dans les institutions communautaires, ainsi que leur position sociale et leurs nombreux privilèges, posent problème parce que ce cocktail les rend insensibles aux attaques que subit la nature, indifférents ou méprisants envers les problèmes et les doléances de leurs concitoyens qui vivent déjà les conséquences d’une planète dégradée et d’une économie qui jette toujours ses bases sur les mêmes paradigmes. Les institutions demanderaient à être mises sous pression (financière ou populaire) pour changer d’elles-mêmes leur grille de lecture.
Une chose permettrait de débloquer la situation en introduisant du débat et en rééquilibrant le pouvoir de décision : il s’agit de la participation démocratique. Une première piste serait d'attribuer au Parlement européen, comme c'est le cas pour la plupart des parlements à travers le monde, l'initiative des lois (directives et règlements). Bien vrai que les différents traités ont élargi considérablement son rôle de colégislateur (partagé avec le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les vingt-huit ministres des États membres en fonction des thématiques abordées), puisqu'il concerne aujourd'hui 85 domaines de compétences. Mais on constate que quelques domaines clés n'y figurent pas, et notamment la politique de concurrence. Étant le seul organe élu au suffrage universel direct au sein de l'Union, on comprend qu'il faille plutôt miser dessus pour espérer une certaine prise de conscience de l'urgence écologique.

L’initiative référendaire, demandée par le mouvement des Gilets jaunes depuis le mois de novembre en France, et qui existe déjà en Suisse où elle est régulièrement pratiquée, constitue un exemple typique d’outil qui, appliqué à l’échelle de la France, de l’Union ou des collectivités territoriales, pourrait forcer la main aux élites. Leur forcer la main pour agir avec réalisme contre le désastre écologique à l’œuvre, pour mieux prendre en compte leurs besoins, pour mettre un terme au bradage des grandes entreprises et du patrimoine de la nation, pour relancer des projets industriels durables et créateurs d’emplois de qualité, et pour lutter contre les inégalités en remettant les services publics au cœur du système de solidarité (Le Référendum d’Initiative Citoyenne, ou comment les Gilets jaunes demandent à démocratiser notre « démocratie » ?). Permettre aux Européens d'interpeler leurs élus et leurs dirigeants, quelle que soit l’échelle, notamment les obliger à répondre aux attentes légitimes de millions d’individus exposés à des villes plus polluées ou à des campagnes aux sols dégradés, n’est pas seulement une question de démocratie, mais aussi un acte de confiance que l’on adresse aux citoyens (Sommes-nous en démocratie ? (3/3) La nécessité de mécanismes participatifs contraignants). Cela signifie qu’on leur attribue cette capacité (et ce droit) à se mêler de la vie de la Cité, à alerter les élites, à proposer des solutions et à les soumettre au vote. Cela signifie aussi que l’on considère l’ensemble des pans de la société comme une même communauté de destin, profondément liée, et finalement consciente que l’effondrement des uns signifie inévitablement, à terme, celui des autres.
* * *
L'extrait suivant est tiré d'une revue de presse de Natacha Polony, publié le 8 septembre 2017 sur la chaîne TV Internet Polony-TV, où la journaliste française décrypte la situation de l'Union européenne au lendemain du discours d'Emmanuel Macron à Athènes, qui précède de quelques jours le fameux discours de la Sorbonne prononcé le 26 septembre 2017. Alors que les représentants de LREM n'ont cessé de répéter que « l'Europe » était indispensable pour que nous puissions nous protéger et nous développer dans le cadre de la mondialisation, la dernière phrase de cet extrait, d'autant plus au regard du bilan de la politique européenne d'Emmanuel Macron depuis deux ans, a évidemment un écho tout particulier.
Pour l’instant l’Union européenne pour les Français, c’est quoi ? Une entité qui exige la libéralisation des services publics, qui laisse les multinationales se domicilier en Irlande ou au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts, qui organise le dumping social, et qui ouvre les frontières à des populations, notamment celles venues de pays de l'Est, qui déstabilisent nos structures d'accueil. [...] On sait tous très bien qu’il n’y aura rien de concret avant les élections allemandes. Nous sommes calés à l’agenda d’Angela Merkel. Et d’ici là, on en est réduit aux grandes déclarations. […] Emmanuel Macron a bougé sur ces questions. Pendant la campagne, il nous a servi le couplet sur l'Europe qui nous apportait tellement, parce qu'il avait besoin du soutien de l'oligarchie pro-européenne. Maintenant, il découvre que la directive « Travailleurs détachés » est catastrophique. C'est formidable de reconnaître ses erreurs, mais ça ne suffit pas. [...]
Pour juger réellement de la politique européenne d'Emmanuel Macron, il faut se donner du temps. Il faut lui donner rendez-vous, dans un ou dans deux ans ; la question à se poser à ce moment-là, ce sera : est-ce qu'il a obtenu, non pas des aménagements à la marge de la directive « Travailleurs détachés », mais le fait qu'on paie les charges dans le pays où est effectué le travail ? Est-ce qu'il aura obtenu une harmonisation de l'impôt sur les sociétés pour mettre fin au dumping fiscal ? Pour l'instant la Commission européenne est contre. Est-ce qu'il aura obtenu son fameux Buy European Act, c'est-à-dire la priorité aux entreprises européennes pour les marchés publics ? Et même, allons plus loin, la préférence communautaire, qui était à la base de l'esprit européen, c'est-à-dire l'ensemble du commerce, avec des droits de douane aux frontières ? Et enfin, très important, est-ce qu'il aura obtenu une défense européenne indépendante de l'OTAN ? Parce que s'il n'y a pas ces quatre points [travailleurs détachés, harmonisation fiscale, Buy European Act, défense européenne], les belles phrases devant l'Acropole, ce sera comme les histoires de Jupiter, ou de Zeus : des mythes.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)

