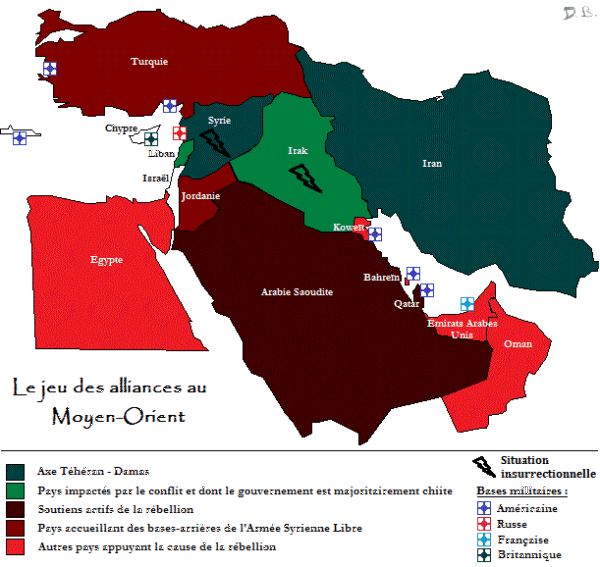Syrie, le 21 août dernier : nous sommes en grande banlieue de Damas, et des dizaines et des dizaines d’enfants sont filmés, suffoquant, agonisant, en convulsion. Ces images ont fait le tour du monde. Du gaz sarin aurait été utilisé contre des civils à une grande échelle, faisant entre 300 et 1.300 morts, selon les sources. La journée du 21 août aurait bien pu représenter un tournant dans le conflit syrien. La proposition russe de placer l’arsenal chimique syrien sous contrôle de l’ONU a finalement évité le scénario de frappes ciblées franco-américaines, qui s’annonçait de toute façon compliqué par une opposition annoncée du Congrès américain. Si elles avaient eu lieu, ces frappes auraient pu, en fonction de leurs objectifs militaires et de leur impact réel sur le terrain, faire basculer le rapport de force en faveur de la rébellion. Face au risque, Bachar el-Assad a brandit la menace d’une « guerre régionale ». Qu’en est-il réellement ? Le jeu d’alliances observé au Moyen-Orient est-il susceptible d’embraser la région, par une sorte d’effet domino qui entraînerait tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans le conflit ? Alors que le compte à rebours des frappes franco-américaines semble momentanément interrompu, quelques éclaircissements sont nécessaires pour bien comprendre la situation régionale.
La recrudescence des combats entraîne inéluctablement un risque de régionalisation du conflit. D’abord parce que tous les pays limitrophes sont plus ou moins directement concernés, au moins à cause de l’afflux de réfugiés depuis l’été 2011. Ils seraient à présent 150.000 en Irak, 320.000 en Turquie, 450.000 en Jordanie, et presqu’autant au Liban. Ainsi que 50.000 en Égypte, et entre 10.000 et 30.000 dans l’ensemble du Maghreb. Les cas de viols sur des femmes et des filles réfugiées en Turquie (plus de 800 cas enregistrés en 2011-2012) ou au Maghreb, la situation de mendicité de la communauté syrienne réfugiée en Algérie, ou encore les émeutes anti-réfugiés dans le village turc de Reyhanli, en mai 2013, sont des exemples parmi tant d’autres qui révèlent les conséquences dramatiques de cette situation.
Un jeu d'alliances régionales complexe
Les tentatives de médiation internationale ont jusqu’à présent toutes échoué. Après les tentatives vaines de la Ligue arabe en 2011, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a pris le relai. Mais elle n’a pas eu plus de succès, comme l’a illustré la démission de Koffi Annan de son poste de médiateur en août 2012. Considérée par la Russie et la Chine comme un instrument trop souvent mis au service des intérêts américains, l'ONU a été très vite paralysée par leur statut de membres permanents du Conseil de sécurité. Les deux puissances n’ont pas apprécié le précédent libyen, au cours duquel les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont largement outrepassé les prérogatives octroyées le 17 mars 2011 par la résolution nº1973 de l’ONU, en livrant des armes aux insurgés libyens et en favorisant la chute de Mouammar Kadhadi, en août 2011. Le 4 octobre 2011, puis à nouveau le 4 février et le 19 juillet 2012, Moscou et Pékin opposaient leur veto à une condamnation de la répression et à des sanctions contre le régime syrien. Liée au régime baathiste depuis la Guerre froide, la Russie tient à maintenir son allié le plus fidèle au Moyen-Orient. Elle stationne toujours dans le port de Tartous (près du Liban) plusieurs de ses navires militaires, et demeure le premier marchand d’armes de la Syrie. Quant à la Chine, son soutien tient plus à un alignement spontané sur la position russe, et à ses relations commerciales privilégiées avec l’Iran, qu’à ses liens avec Damas.

Après maintes hésitations, certains États ont finalement opté pour un soutien affirmé aux rebelles. La Turquie d’abord, qui sert de base-arrière à la rébellion armée et à l’opposition en exil. Au cours de l’été 2012, les insurgés syriens se sont emparés de vastes espaces proches de la Turquie, entraînant une porosité croissante de la frontière et un flux logistique continu approvisionnant la rébellion en munitions, en armes légères et moyennes et en armes antichars. Par le sol turc, le Qatar, l’Arabie Saoudite et la Turquie fournissent des aides diverses aux insurgés (cargaisons d’armes d’origine ukrainienne ou croate, aide non-létale, etc.).
Car les monarchies du Golfe, rivales de l’Iran, ont compris tout l'intérêt qu'elles trouveraient à la chute du régime de Damas, pilier du réseau d’alliances régionales tissé par Téhéran depuis trois décennies. Il faut dire que les puissances montantes de cette organisation régionale, l’Arabie Saoudite et le Qatar, sont des rivaux notoires de Damas. Elles ont été les premières à avoir, le 12 novembre 2012, reconnu la Coalition nationale de l’opposition syrienne comme le « représentant légitime » du peuple syrien. Le gouvernement Erdogan, qui voit par ailleurs d’un mauvais œil la montée en force de milices kurdes dans le nord de la Syrie depuis juillet 2012, a quant à lui fait le choix de tourner le dos au régime syrien, pour se mettre du côté de la rue arabe. Un changement de ton surprenant, après le réchauffement diplomatique observé à partir de 2007 entre Ankara et Damas. Ce revirement n’est pas sans conséquence pour la sécurité de la Turquie. En février et en mai dernier, des attentats à la voiture piégée, respectivement dans un poste-frontière et puis dans un village turc frontalier, étaient imputés à des groupes affiliés au régime syrien. Et, annoncé en mai dernier par Ankara, un mur de deux mètres de haut sera construit à partir du mois prochain sur un petite partie de la frontière turco-syrienne, à l'extrême nord-est de la Syrie, dans une zone où les affrontements entre rebelles kurdes et tribus arabes sont fréquents : les autorités turques espèrent ainsi enrayer le phénomène croissant de contrebande et de passages clandestins de combattants (kurdes et, surtout, djihadistes).
Surtout, du 3 au 9 octobre 2012, l’armée turque répondaient à des obus syriens atterris sur son sol en opérant des tirs d’artillerie contre des positions des forces militaires syriennes. Si le régime de Bachar el-Assad n’a pas riposté à ces attaques, cet épisode aura au moins eu pour conséquence de motiver un renforcement du dispositif de défense de l’OTAN en Turquie : dès janvier 2013, les États-Unis, les Pays-Bas et l’Allemagne déployaient chacun deux batteries de missiles sol-air, et jusqu’à 400 soldats supplémentaires. Un arsenal qui annonçait la montée des tensions actuellement observée entre la Syrie et les États-Unis. En effet, le 10 mai dernier, la Russie finalisait quant à elle la livraison de missiles de défense aérienne au régime de Bachar el-Assad. Par ailleurs, le travail de restructuration de l’armée syrienne, désormais limitée dans sa capacité de projection, doit beaucoup à l’alliance avec la Russie et l’Iran : encadrée et conseillée par des instructeurs iraniens, et approvisionnée en armes par la Russie et l’Iran tout au long du printemps 2013, elle a ainsi pu renforcer sa stratégie destinée à dégager et à sécuriser l’épine dorsale du « pays utile », qui va de Damas à Lattaquié. Le rôle joué par le Hezbollah dans la bataille de Qousseir (mai et juin 2013) a lui-aussi été déterminant au succès de cette stratégie. Afin de poursuivre l’isolement géostratégique de la Syrie dans la région, les États-Unis ont renforcé cet été leur dispositif militaire en Jordanie, avec une livraison conséquente de batteries de missiles anti-aériens et de chasseurs F-16.

La Jordanie justement, a longtemps adopté une attitude ambigüe vis-à-vis du régime baathiste, pourtant un ennemi idéologique de longue date. Elle-même touchée par des mouvements de protestation en 2011 et en 2012, la monarchie Hachémite considère avec une grande méfiance l’opposition islamiste présente dans la rue jordanienne. D’où un attentisme prudent de la part d’Amman au cours des premiers mois de la Révolution syrienne. Il aura fallu l’afflux de réfugiés syriens – ils représentent désormais 10% de la population jordanienne ! – dans un pays déjà si marqué par la présence de réfugiés palestiniens, et l’insistance de la diplomatie américaine, pour faire évoluer la position du roi Abdallah II.
Ce revirement jordanien nous fait revenir aux sources du drame du 21 août dernier. A l’origine de l’attaque au gaz sarin, on trouve la nouvelle stratégie des États-Unis et de l’Arabie Saoudite dans le conflit syrien. En effet, face à la dimension anarchique des combats dans le nord du pays, Riyad, Washington et Amman appuient l’ouverture d’un nouveau front. Les États-Unis supervisent des formations, la Jordanie prête son territoire, et l’Arabie Saoudite finance des livraisons d’armes, le tout au profit de groupes affiliés à l’Armée Syrienne Libre.
L’objectif est de renforcer et de professionnaliser l’Armée Syrienne Libre, aux dépends des milices djihadistes, qui reçoivent quant à elle leurs financements et leurs armes, non pas du royaume saoudien ou de l’émirat qatari comme on le dit trop souvent, mais plutôt de cheikhs arabes multimillionnaires (koweïtiens, émiratis, saoudiens…), ainsi que de la nébuleuse Al-Qaïda, qui peut se servir de sa base irakienne à cette fin. La diplomatie saoudienne, qui soutient depuis longtemps des milices islamistes indépendantes d'Al-Qaïda (comme la brigade Farouq, ou Liwa el-islam) – alors que le Qatar appuie des groupes proches des Frères musulmans (tel que Liwa Tawhid) –, suit désormais la stratégie américaine, dans le but d’ouvrir un nouveau front, moins anarchique et géographiquement plus proche de Damas. Dès la fin de l’année 2012, des avions croates chargés d’armes financées par l’Arabie Saoudite (canons sans recul, lance-grenades, missiles antichars, etc.) se posaient à Amman. Pas moins de 4.000 hommes entraient ainsi au sud du territoire syrien, ouvrant à partir de mars 2013 un nouveau front dans la Ghouta, à l’est de Damas. Le 17 puis le 19 août dernier, plusieurs centaines de nouveaux combattants de l’Armée Syrienne Libre ont traversé la frontière jordanienne. C’est leur percée en grande banlieue damascène qui aurait provoqué la riposte à l’arme chimique du 21 août.

L’exception israélienne
Israël présente une posture pour le moins exceptionnelle dans cet échiquier complexe. En deux ans et demi, l’État hébreu n’a reçu aucun réfugié syrien, et pour cause, la militarisation du plateau du Golan rend sa traversée périlleuse. La très large supériorité militaire d’Israël et sa posture officiellement neutre depuis le début du conflit mettent le pays à l’abri de tout danger réel – même si les images d’Israéliens se fournissant massivement en masques à gaz, ces dernières semaines, peut faire penser que les citoyens de ce pays n’en ont eux-mêmes pas vraiment conscience. Certes, Israël est déjà intervenu en Syrie ces derniers mois. En novembre 2012 et en mai 2013, des tirs sporadiques avaient déjà été échangés entre les deux camps, sur le plateau du Golan.
Surtout, l'État hébreu, jusque-là attentiste, est sorti de sa réserve le 30 janvier dernier, lorsque son aviation a mené des raids à la frontière libano-syrienne, sur un convoi de missiles sol-air alors en route vers le Liban et sur des bâtiments soupçonnés d'abriter des armes chimiques. Le 3 et le 5 mai, l’armée israélienne a opéré de nouveaux raids aériens au nord de la région de Damas, touchant le centre de recherche militaire de Jamraya et des dépôts d’armes et de munitions (probablement d’origine iranienne).
Toutefois, ces attaques ne visaient pas tant l’affaiblissement du régime syrien, qu’à prévenir des livraisons d’armes à destination du Hezbollah – on se rappelle que déjà en septembre 2007, l'aviation israélienne avait bombardé de manière préventive un complexe militaire syrien suspecté d'abriter du matériel nucléaire en provenance de Corée du Nord. Surtout, l’absence de réaction (autre que verbale) de la part de Bachar el-Assad à chacune des frappes israéliennes révèle l’incapacité du régime syrien à mener un nouveau front contre ce qui reste la première puissance du Proche-Orient. Israël s’est par ailleurs attelé à prévenir toute contre-attaque syrienne. Le 6 janvier 2013, l’État hébreu annonçait le renforcement de la clôture de sécurité le long de sa ligne de démarcation avec la Syrie, sur le plateau du Golan, avant de déployer, en mai dernier, deux batteries antimissiles près de sa frontière avec le Liban.
Dans le Golan, les stigmates des guerres passées sont encore très présents, y compris dans les esprits. Ici à Quneitra, en 2009 (© Boudour Moumane).
Le risque d’embrasement confessionnel, déjà une réalité au Liban et en Irak
L’Irak et le Liban sont de très loin les deux pays les plus sensibles aux impacts de la crise syrienne. Pour chacun d’entre eux, cela s’explique par une vie politique nationale marquée par les tensions confessionnelles et par la militarisation des différentes communautés qui se font face. Occupé par la Syrie jusqu’en 2005, le Liban est le pays le plus exposé à un risque de contagion du conflit. Largement dominé depuis juin 2011 par des ministres liés au Hezbollah, le gouvernement libanais n’en a pas moins adopté une posture de neutralité officielle. Des heurts ont tout de même éclaté dans la ville de Tripoli, entre citoyens sunnites et alaouites, au cours de l’été 2012, et à nouveau en décembre 2012 et en mars 2013. Surtout, le 16 février dernier, le Hezbollah, déjà impliqué dans le conflit syrien par l’action de certains de ses miliciens dans la répression du régime, lançait une offensive au-delà de la frontière, s’emparant de huit villages tenus auparavant par l’Armée Syrienne Libre. Le 18 mars 2013, l’armée syrienne menait quant à elle un raid à la frontière, près de la ville libanaise d'Arsal, dans la zone de Wadi Khail, qui, comme d’autres à la frontière orientale du Liban, sert de base-arrière aux rebelles syriens.
En mai et en juin dernier, le Liban subit de plein fouet les contrecoups de la participation du Hezbollah à la bataille de Qousseir (petite localité syrienne proche de la frontière du Nord-Liban) : roquettes ou missiles tirés à l’aveugle sur le sol libanais, appels de prédicateurs chiites ou sunnites pour aller combattre tel ou tel camp en Syrie, affrontements entre sunnites et alaouites à Tripoli, déclarations belliqueuses du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, sont autant d’éléments qui s’ajoutent à l’implication désormais totale et assumée du Hezbollah dans le conflit. Un engagement du mouvement chiite qui entraîne d’ailleurs des critiques quasi-unanimes du reste de la scène politique libanaise. La situation sécuritaire du Pays du Cèdre est devenue particulièrement préoccupante, et rappelle les heures sombres de la guerre civile. L’attentat du 19 octobre 2012, qui avait fait près d’une quinzaine de morts (dont le chef du Service des Renseignements Libanais, proche de Saad Hariri) et environ 80 blessés, dans un quartier chrétien de Beyrouth, était déjà illustratif du degré d’instabilité régnant dans le pays. Plus récemment, à l’attentat du 15 août dernier, qui a fait une vingtaine de morts et 200 blessés dans un fief du Hezbollah, en banlieue sud de Beyrouth, a succédé le 23 août un double attentat à la voiture piégée dans la ville de Tripoli, qui a fait une cinquantaine de morts et 500 blessés.
En Irak, la situation particulièrement chaotique provoquée par l’entrée sur le territoire de djihadistes d’Al-Qaïda, à la faveur de l’occupation américaine, a favorisé un contexte propice à une contagion de la crise syrienne. De fait, les deux conflits (irakien et syrien) se font écho, puisque de nombreux combattants étrangers actuellement présents sur le sol syrien avaient auparavant combattu en Irak. Il est par ailleurs probable que de nombreux groupes islamistes luttant aujourd’hui en Syrie aient leur base-arrière en Irak, et qu’ils s’y fournissent en armes et en munitions. C’est le cas du Front al-Nosra – le 9 avril 2013, la direction d’Al-Qaïda en Irak révélait qu’elle parrainait al-Nosra –, mais également, comme son nom l’indique, de l’État Islamique de l’Irak et du Levant, une milice qui monte en puissance ces derniers mois dans le nord-est de la Syrie. Les sympathies qui existent entre le régime de Bachar el-Assad et le gouvernement al-Maliki, dominé par des ministres de confession chiite, ne sont pas étrangères à la recrudescence des violences en Irak ces derniers mois.
Car le Premier ministre irakien a opéré, à la faveur de son second mandat amorcé en 2010 et du retrait des forces américaines en 2011, un virage diplomatique notable. En se rapprochant de la Russie et de la Chine, tout d’abord, ce qui se traduit par la signature d’importants contrats d’armement avec ces deux pays, pour afficher son indépendance vis-à-vis des États-Unis. En faveur de l’Iran, ensuite : seconde puissance à posséder des troupes en Irak (à travers la présence de milices chiites ou de soldats privés), l’Iran partage en effet, en dépit des rivalités apparues dans les années 1980, des liens profonds et historiques avec l’Irak, cristallisés aujourd’hui dans le partage d’une même religion, l’islam chiite. Avec la Syrie, enfin. Lorsque le soulèvement pacifique prend forme en mars 2011, Bagdad affiche sa sensibilité à l’égard de la cause démocratique défendue dans les rues syriennes, les chiites irakiens ne pouvant, au regard de la répression qu’ils avaient eux-mêmes connue, cautionner les massacres du régime syrien contre son peuple. Mais la confessionnalisation d’une insurrection qui dure depuis déjà plus de deux ans favorise l’ancrage du gouvernement irakien dans un « croissant chiite » (selon le bon mot du roi jordanien en 2004) s’étendant de Beyrouth à Téhéran, mais menacé par la Révolution en Syrie.
A cela s’ajoute la volonté de Nouri al-Maliki de couper court à l’élan de solidarité existant entre les sunnites syriens et irakiens, permise par la porosité de la frontière commune, devenue un point de passage privilégié pour les djihadistes sunnites – le poste-frontalier de Yaarubiyeh, notamment, se situe près de la ville de Mossoul, une des places fortes de la branche d’Al-Qaïda en Irak. Le 4 mars dernier, en Irak où il s’était réfugié quelques jours auparavant, un convoi de 42 fonctionnaires et soldats syriens était massacré (avec sept soldats irakiens) pendant son retour en Syrie, victime d’une embuscade de militants d’Al-Qaïda en Irak. En mars toujours, l’opposition syrienne, ainsi que les chefs de la tribu irakienne des Chammars, accusaient l’État irakien de « bombarder des positions rebelles » près de la frontière. Le 19 mars suivant, les États-Unis reprochaient même à l’Irak de laisser des vols iraniens traverser son espace aérien pour fournir des armes au régime syrien. La recrudescence des attentats en Irak ces derniers mois (plus d’un millier de morts pour le seul mois de ramadan, en juillet 2013, et plus de 5.000 depuis le début de l'année) révèle de quelle manière tragique l’Irak sombre peu à peu dans une guerre civile interconfessionnelle que le contexte régional et les dérives autoritaristes de Nouri al-Maliki vis-à-vis de la communauté sunnite en Irak favorisent largement.
Après des frappes occidentales, l’escalade ?
Les systèmes d’alliance sont donc posés. La Turquie est fortement engagée dans le soutien des rebelles, de même que ne l’est l’Iran vis-à-vis du régime, jouant là une partie d’échecs déterminante pour sa crédibilité géopolitique. Ces deux puissances montantes du Moyen-Orient ont sans le vouloir engagé un bras de fer dont doit pâtir le peuple syrien. Le Qatar et l’Arabie Saoudite sont eux-aussi engagés, mais de manière plus distante : sur le plan dialectique au moins, leurs objectifs sont essentiellement diplomatiques. Devenus maîtres dans l’art d’agir dans l’ombre, il est improbable que les pays membre du Conseil de Coopération du Golfe soient entraînés dans une éventuelle guerre régionale.
Mais qu’en est-il des autres États présents dans la région ? Le 23 et le 29 août, les États-Unis ont renforcé leur présence en Méditerranée, au sein de leur VIème flotte, en déployant un quatrième et un cinquième destroyers, équipés de missiles de croisière. S’ajoutent une flotte américaine dans la mer Rouge, et une base navale en Turquie, en Grèce, en Sicile, au Koweït, au Qatar et à Bahreïn. La France a quant à elle envoyé en Méditerranée une frégate de défense, le Chevalier Paul, et elle dispose d’un base aux Émirats et à Djibouti. Réponse des Russes : Moscou a dépêché fin août deux bâtiments, un bateau de lutte anti-sous-marine et un croiseur lance-missiles, en direction de sa base militaire de Tartous, sur la côte syrienne. Début septembre, elle y envoyait encore au moins quatre bâtiments, dont trois bateaux de débarquement. La flotte russe compte au total à Tartous une dizaine de navires et un nombre non communiqué de sous-marins. Mais ces manœuvres navales ne doivent pas faire illusion. On est loin d’un retour à la Guerre froide. Le régime russe veut faire savoir aux Occidentaux qu’il compte encore en Méditerranée, face à la mise en péril de son allié syrien ; toutefois le risque de riposte russe est tout simplement nul en cas de frappes américaines. Si Moscou ne s’est pas lancé dans une guerre avec les États-Unis à l’époque où la Russie rivalisait encore avec la puissance américaine, pourquoi prendrait-elle ce risque aujourd’hui ? Son armée reste la deuxième au monde, mais elle n’a toujours pas achevé sa transition post-soviétique – le plan de renouvellement et de modernisation de la flotte navale russe a commencé cette année et doit s’étaler jusqu’en 2030.
Donc, pas de guerre mondiale, mais peut-on craindre une guerre régionale ? Il est entendu que des frappes occidentales pourraient déclencher une réaction en chaîne qui embraserait une partie du Moyen-Orient. La Syrie, d’abord, pourrait y répondre par une riposte aérienne contre les camps d’entraînement de l’Armée Syrienne Libre en Jordanie, ainsi qu’en visant des bases-arrières rebelles au Liban ou en Irak. Elle pourrait également inciter le Hezbollah à multiplier les attentats au Liban. Il est en revanche peu probable que le régime de Damas cherche à toucher des cibles turques ou israéliennes, car une riposte aérienne ou même terrestre de l’un de ces deux pays pourrait lui être fatale. De son côté, l’Iran pourrait envoyer des missiles balistiques sur Israël en représailles – on se rappelle que le régime de Saddam Hussein n’avait pas hésité à envoyer plusieurs missiles SCUD sur Tel-Aviv et Haïfa en janvier 1991, en pleine Guerre du Golfe –, mais c’est là encore prendre le risque d’une violente riposte de l’État hébreu, une occasion que les Israéliens, irrités par l’affaire du nucléaire iranien, ne se priveront sans doute pas de saisir. Scénario plus probable : l’Iran, ne disposant pas de beaucoup moyens de pression ni d’une frontière avec la Syrie, pourrait, outre inciter le Hezbollah à multiplier les attentats au Liban ou les lancements de roquette contre Israël, déployer sa flotte navale pour bloquer le détroit d’Ormuz, par lequel transite un grand nombre de pétroliers, entraînant ainsi un nouveau choc énergétique dont pâtiraient essentiellement les pays occidentaux. Mais ne doutons pas que cela entraînerait une offensive américaine contre la flotte iranienne, et donc des affrontements aéronavals dans le golfe Persique.
La Turquie pourrait elle-même prendre l’initiative de bombarder ou d’intervenir au sol dans les zones où elle considère que ses intérêts sont en jeu, notamment dans les territoires kurdes de Syrie. Un scénario qui n’est pas si absurde quand on se rappelle qu’en février 2008, l’armée turque avait allègrement traversé la frontière irakienne pour y mater des éléments de la résistance kurde, avant de bombarder dans le courant de l’année des bases-arrières kurdes sur le sol irakien. De tels objectifs de guerre semblent toutefois peu probables dans le contexte politique actuel, où le PKK vient d’amorcer un cycle de négociations avec Ankara. Mais une intervention exceptionnelle de la Turquie, qu'elle qu'en soit ses modalités, n'est pas totalement à exclure dans un futur plus ou moins lointain, si le gouvernement Erdogan l'estimait nécessaire. Rappelons que le 22 juin 2012, un avion de combat F-4 turc était abattu par les services de la défense anti-aérienne syriens, alors qu'il effectuait au cours d'une mission d'entraînement une brève incursion dans l'espace syrien ; de la même manière, le 16 septembre dernier, un avion turc abattait un hélicoptère militaire syrien de type MI-17, détecté à deux kilomètres à l'intérieur de l'espace aérien turc.

La réalité géopolitique actuelle peut donc nous laisser penser qu'en cas de frappes franco-américaines, ni l’Iran, ni la Russie ne prendront le risque d’entrer dans un conflit général où pourraient être impliquées trois des plus grandes puissances agissant dans la région : la Turquie, Israël et les États-Unis. Pas de syndrome Gavrilo Prinzip à l’horizon, du nom de cet étudiant serbe qui a commis l'attentat à l'origine de la Première Guerre mondiale. Le jeu d’alliances en place, et notamment l’axe Moscou-Téhéran-Damas (auquel on peut associer le Hezbollah et dans une moindre mesure Pékin et Bagdad), n’est pas suffisamment fort pour faire basculer tous les alliés du clan Assad dans une guerre.
En cas d’effondrement définitif de l’État syrien, il est bien plus probable que l’Iran, la Russie et le Hezbollah s’attèleront avant tout à soutenir la création d’un État alaouite sur la côte syrienne ; les éléments de la flotte russe stationnés à Tartous pourraient alors entrer en action – ironie de l’histoire, la Russie pourrait le faire au prétexte de « protéger les populations civiles » menacées par les groupes djihadistes… ou de l’art de reprendre la rhétorique occidentale à son avantage. En cas d’implosion de la Syrie, le risque majeur concerne bien l’Irak et le Liban, où les tensions communautaires ont rarement été si grandes, et où le scénario d’une partition territoriale n’est pas à exclure totalement, même s’il reste encore hors de propos actuellement.
Comment (et peut-on) sortir de la crise syrienne ?
On est en droit de se demander quel est le sens de la « ligne rouge » posée par les États-Unis, lorsque le conflit a déjà fait plus de 110.000 morts, deux millions de déplacés en dehors du pays, et quatre millions à l’intérieur. Le casus belli est évidemment absurde. Près de la moitié des personnes déplacées étant des enfants, on assiste là à l’émergence d’une génération de Syriens marqués par la guerre et ses conséquences. Si elle doit avoir lieu, la possible intervention franco-américaine intervient trop tard. Le moment idéal pour armer les rebelles, voire pour créer une « zone d’exclusion aérienne » susceptible de faciliter leur progression vers Damas, aurait dû intervenir avant l’été 2012, c’est-à-dire avant que ne rentrent dans la danse des groupes djihadistes noyautés par des islamistes étrangers qui ont à présent pris une place prépondérante sur le plan militaire. Selon le journal allemand Bild le 8 septembre dernier, les services de renseignement allemands auraient révélé récemment que l’Armée Syrienne Libre « aurait perdu le contrôle militaire, et que le flot de déserteur de l’armée régulière la rejoignant serait désormais nul, notamment parce que des forces d’Al-Qaïda fusilleraient ces derniers ». Au vu de cette situation, un effondrement précipité de l’État syrien est-il souhaitable, alors le Front al-Nosra, jusque-là essentiellement présent dans le nord du pays, vient de réaliser une percée dans le nord de la province de Damas, en prenant le village chrétien de Maaloula ?
La stratégie américaine visant à la formation de contingents de rebelles syriens dans des camps en Jordanie est sûrement la bonne : elle vise à renforcer l’Armée Syrienne Libre et à lui donner l’ascendant dans la région de Damas. Révélatrice d’un certain affolement du régime, l’attaque du 21 août montre au moins que les États-Unis ont tapé juste. Peu probable compte tenu des réticences de la classe politicienne américaine, la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne entre la frontière jordanienne et Damas serait d’ailleurs d’un grand soutien pour la rébellion.
Pour autant, le risque de démembrement de la Syrie par les différentes milices agissant sur le territoire, liées à Al-Qaïda, à l’Armée Syrienne Libre, à la résistance kurde, au Hezbollah, aux Chabihas du régime, ou encore aux comités d’autodéfense populaire alaouites, doit obliger toutes les parties désireuses de préserver le pays à revenir à la table des négociations politiques. Sans pour autant relâcher la pression sur le régime syrien. Car, si au bout d’un an de répression, dialoguer avec le clan Assad était compromis par les massacres, désormais, la présence de djihadistes dans l’insurrection et le degré de violences de part et d’autre imposent de laisser de côté les rancœurs pour comprendre les peurs des uns et des autres et amorcer des négociations. Ce slogan des groupes islamistes : « Les chrétiens à Beyrouth, les alaouites dans la tombe ! » est un avertissement que ne doivent pas ignorer les Occidentaux.
Si solution militaire il y a, elle doit venir de ce front méridional. Mais elle pourrait entraîner la sécession du pays alaouite, et l’exil de nombreux chrétiens. A l’heure où Russes et Syriens acceptent de négocier une mise sous tutelle et une destruction de l’arsenal chimique syrien, un cycle de négociations, sous médiation de l’ONU ou des puissances impliquées dans le conflit, doit être ouvert. Le démantèlement de l’arsenal chimique syrien s’annonce particulièrement long et périlleux – à titre d’exemple, les États-Unis et la Russie, qui ont lancé à la fin des années 1990 la destruction de leurs stocks d'armements chimiques issus de la Guerre froide (30.000 tonnes pour les États-Unis et 40.000 pour la Russie), n’achèveront cette tâche qu’au début des années 2020, malgré les énormes moyens scientifiques et industriels mis en œuvre. Pour autant, le fait est là : les Russes sont parvenus à ramener les Syriens dans le jeu des discussions internationales, puisque l'ONU est dans l'obligation de négocier avec eux pour pouvoir mettre en application l'accord russo-américain sur le démantèlement de leurs armes chimiques. Une occasion à saisir, en dépit de la frustration exprimée par les rebelles sur le terrain. A cet égard, la fin du mandat de Bachar el-Assad, prévue pour mai 2014, est une échéance intéressante pour amorcer une transition négociée. La mise en place d’un système fédéral permettant le repli des minorités dans un « État alaouite » autonome, proposée par l’ancien ministre des Affaires étrangères français Dominique de Villepin les 2 et 4 septembre dernier à la télévision française, pourrait également être une piste pertinente.
Stabilité politique et économique, haut niveau d’éducation, multiconfessionnalisme assumé : lorsqu’éclate en mars 2011 la Révolution, la société syrienne est sans doute, parmi tous les pays arabes, celle la plus propice à une transition démocratique – comme l’avait déjà révélé le « printemps de Damas », en 2000-2001. L’escalade de la violence et la percée des islamistes, causées par la répression opérée par le régime et par son instrumentalisation des tensions communautaires, constituent le grand échec de Bachar el-Assad. Et le drame de la Syrie, à présent, est qu’aucune solution envisageable n’est la bonne : en effet, l’argument du régime selon lequel l’après-Assad représenterait un saut dangereux dans l’inconnu, n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui. C’est sans doute le succès de la dictature, que d’avoir réussi à rendre sa chute encore plus terrifiante que son maintien.
* * *
Le passage qui suit est tiré d'un débat issu de l'émission TV Ce soir (ou jamais !) sur France 3, le 4 septembre dernier. La discussion jette ses bases sur la nécessité ou non de frappes ciblées franco-américaines en Syrie. Frédéric Encel, essayiste, géopolitologue et professeur de relations internationales, s'exprime alors en ces termes : « [Si un certain nombre de conditions sont requises], d’une manière ou d’une autre, pour une raison de crédibilité, mais également pour une raison de dissuasion, il faudra intervenir. [...] Pourquoi ? Pour une raison de crédibilité. Je suis de ceux qui considèrent que la puissance doit être assumée. La puissance, qu'elle soit occidentale ou pas, n’a rien de honteux [quand elle est] au service du droit, qu’il s’agisse du droit [de la légalité] internationale ou du droit au service du "moindre mal". De temps en temps, il faut pouvoir utiliser la force. Il y a des guerres justes ». À cela, Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères français (2002-2004), répond en ces termes :
S’appuyer sur le paradigme de la puissance, et dire que la puissance doit s’exercer pour faire valoir les valeurs et la légitimité. Prolongeons un peu [ce] raisonnement.
La puissance est en train de changer de main. Dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, la première puissance mondiale ne sera plus les États-Unis. [Fera-t-on] le même raisonnement, quand dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, d’autres pays, comme la Chine, utiliseront le même argument que celui qu’utilisent les États-Unis ? Nous [voyons aujourd’hui] notre monde basculer. Nous sommes à la fin d’un monde. Et [certains] voudraient s’appuyer sur des arguments de puissance à un moment où la puissance change de main.
Le monde ne peut être fondé que sur des arguments de sécurité collective. Et c’est pour cela que, même si les Nations Unies ne fonctionnent pas bien, il ne faut pas séparer la légitimité de la légalité. Parce que nous nous verrons imposer, dans un certain nombre de décennies, par la force [d’une] nouvelle puissance, appuyée sur une autre vision de la légitimité, exactement ce que nous prétendons aujourd’hui imposer à d’autres.
Nous ne sommes plus dans un monde où on peut imposer sa vision, imposer sa puissance. Il faut négocier des compromis, même si c’est dans des conditions difficiles. C’est là tout le sujet avec la Syrie : il faut inventer de nouveaux mécanismes de négociations. [Ceux existants] sont certes insatisfaisants. […] Mais l’argument de la force et de la puissance, aujourd’hui dans les mains de « peuples amis » (comprendre : les États-Unis), ne préjuge pas du monde que nous allons bâtir. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette solution.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)