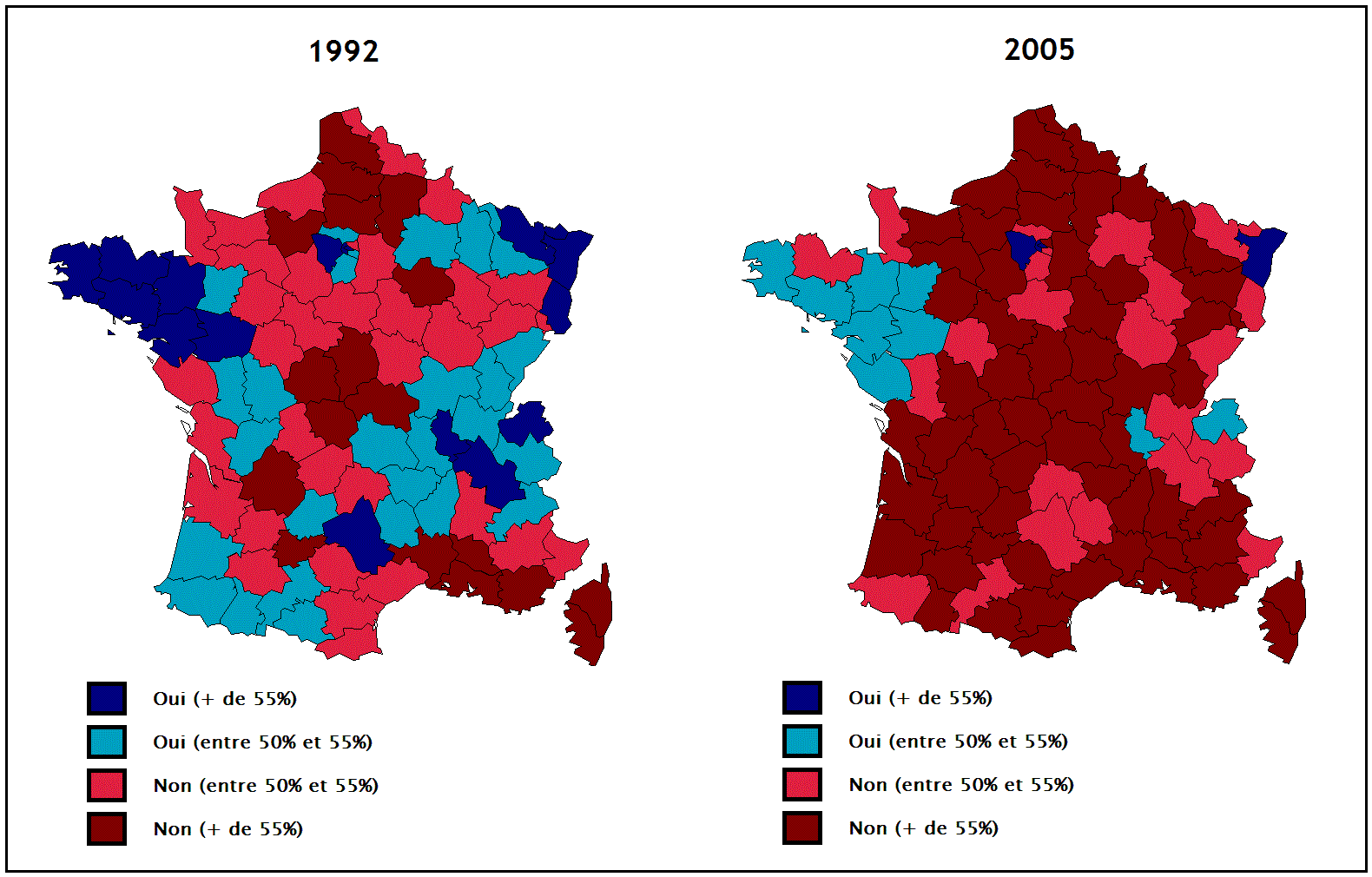Par David Brites.
Alors que l’année 2016 est arrivée à son terme, la rétrospection des évènements politiques qui ont marqué l’actualité européenne des douze derniers mois nous pousse à nous arrêter sur le plus important : le référendum du 24 juin outre-Manche. Ce jour-là, les Britanniques étaient appelés à répondre à cette question : « Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l’Union européenne ou quitter l’Union européenne ? » À 51,89% des voix exprimées, la réponse « Quitter l’Union européenne » (Leave the European Union) l’emportait sur le maintien (Remain a member of the European Union). Entre les deux, une différence d’un million 269.000 voix. Le tout pour un taux de participation très correct, à savoir 72,2% des électeurs inscrits.
Cette consultation a fait l’effet d’une bombe au sein de l’Union européenne, qui, pour la première fois depuis la création de la CEE en 1957 (si l’on excepte le cas de l’Algérie française en 1962 et du Groenland en 1985, qui n’avaient toutefois pas un statut d’État à part entière), va non pas s’élargir, mais « se réduire » géographiquement. Et avec le départ d’un membre qui n’est pas n’importe lequel, tout de même la cinquième puissance mondiale (et la troisième de l’UE, en termes de PIB).
Si l’article 50 du Traité de Lisbonne permettant la sortie d’un État-membre ne sera pas activé avant 2017, le départ du Royaume-Uni ne fait évidemment plus de doute. Ce vote survient onze ans après les référendums de 2005 consacrant le « non » des Français et des Néerlandais au traité établissant une Constitution pour l'Europe. Dans un cas comme dans l’autre, pour la France comme pour le Royaume-Uni, ces résultats ont provoqué des cris d’orfraie dans la classe politique (à l’échelle nationale et européenne), dans les médias traditionnels, ainsi que sur les réseaux sociaux. Quelques éléments de réflexion sur le vote des peuples français et britannique, à une décennie d’écart.
Avec le départ des Britanniques, l'Europe des 28 devrait revenir au chiffre de 27 membres à l'horizon 2019 ou 2020. Prévues pour durer deux ans à partir de l'activation de l'article 50 du Traité de Lisbonne, les négociations risquent bel et bien de dépasser ce délai.
Après une année 2015 frappée du sceau des gauches radicales, avec l’arrivée au pouvoir de Syriza en Grèce en janvier (et sa reconduction en septembre), le référendum grec de juin rejetant les mesures de rigueur imposées par la Troïka (FMI, BCE, Commission européenne), l’alliance des gauches portugaises débouchant sur un gouvernement anti-austérité en octobre, ou encore la percée de Podemos en décembre, après cette année 2015 donc, l’année 2016 aura été caractérisée par des consultations d’un autre ton. Celle du 6 avril aux Pays-Bas, lorsque les Néerlandais, avec 32,28% de participation, ont refusé à 61% de ratifier l’Accord d’association liant l’Union européenne et l’Ukraine, est passée inaperçue dans les médias. Pourtant, elle fragilisait momentanément la politique extérieure de l’UE vis-à-vis de la Russie. Surtout, la campagne a illustré la méfiance des Néerlandais à l’égard de l’élargissement de l’Union, et des risques d’une immigration venue d’Europe de l’Est. Beaucoup plus récemment, mais aussi assez peu couvert en France (à un moment où l’agression de Kim Kardashian faisait la Une des JT…), le référendum du 2 octobre en Hongrie a donné un résultat sans appel, même si, avec 56,65% d'abstention, il n’a pas atteint le quorum de 50% de participation nécessaire pour être validé : à 98,33% des suffrages exprimés, les votants ont rejeté « l’installation obligatoire de citoyens non hongrois » prescrite par l’Union européenne « sans l’approbation de [leur] Assemblée nationale ». Comprendre : les Hongrois refusent le principe de la relocalisation de réfugiés sur leur sol, prévue dans le cadre de l'UE.
Et entretemps, ce fameux référendum britannique, et la perspective du « Brexit » qu’il entraîne. Le Premier ministre David Cameron s’était lié les mains avec cette promesse de campagne, lors des législatives de 2015. Il était pourtant parvenu à imposer à ses partenaires européens des négociations qui avaient abouti, le 19 février 2016, à un accord offrant au Royaume-Uni plus de marge de manœuvre au sein de l’Union européenne. Le lendemain du vote, il annonçait sa démission, effective lors de la passation de pouvoir avec Theresa May le 13 juillet dernier.

Au Royaume-Uni comme en France : ce que dit le vote des catégories populaires
La situation au Royaume-Uni, même onze ans après le référendum de 2005, fait étrangement écho à celle de la France. C’est également le cas, dans une moindre mesure, aux Pays-Bas, où sur la question européenne, le fossé s’est progressivement creusé entre le peuple, qui votait à 61,54% contre la Constitution européenne en 2005, et la classe politique dirigeante, toujours farouchement europhile, à près de 80% – c’était, cumulées, le nombre de voix recueillies par les partis favorables à l’Union européenne aux législatives néerlandaises de 2012.
Les similitudes entre les deux rives de la Manche sont frappantes. Les deux pays connaissent une poussée des partis nationalistes et eurosceptiques (Front national en France, UK Independence Party au Royaume-Uni), derrière lesquels court la droite (UMP/Les Républicains dans l'Hexagone, le Parti conservateur outre-Manche). Aux élections européennes de 2014, le FN avec 24,86% et l’UKIP avec 26,60% des voix avaient d’ailleurs créé la surprise en arrivant en tête dans leur pays respectif. La différence étant qu’au Royaume-Uni, où le rapport à la mondialisation et à l’immigration diverge de celui observé en France, l’extrême-droite ne parvient à percer qu’en se concentrant sur la question de la souveraineté nationale vis-à-vis de l’Union européenne. En témoignent les scores désastreux du British National Party, nationaliste, anti-immigration et anti-mondialisation, qui n’a jamais fait mieux que 1,9% des voix aux législatives (c'était en 2010) et 6,3% aux européennes (en 2009). En France, la droite nationale parvient à percer sur la base de thématiques plus larges, pas seulement sur l’Europe.
Entre la France et le Royaume-Uni : deux États au PIB similaires et à la population équivalente, deux anciennes puissances coloniales, seuls pays de l'Union européenne à siéger de façon permanente au Conseil de sécurité de l'ONU et à détenir l'arme nucléaire. Deux grandes puissances qui peuvent encore se prévaloir d'une influence dans des régions extra-européennes (Moyen-Orient et Afrique australe pour Londres, Afrique de l'Ouest et centrale pour Paris) et d'une capacité de projection dont peu d'États dans le monde peuvent se targuer. Pays d’immigration depuis au moins l’après-guerre, eux qui ont été historiquement le cœur de la démocratie libérale européenne, et dont les zones industrielles (à l’est et au nord de la France, au nord de l’Angleterre) ont été violemment frappées par les mutations économiques liées à la mondialisation depuis les années 1970. Entre ces deux nations donc, les similitudes sont grandes. Interrogé par le site Atlantico.fr, Emmanuel Todd n’expliquait pas autre chose, dans un article publié le 3 juillet : « Il y a un grand mensonge des élites françaises lorsqu’elles prétendent se méfier de l’Angleterre. [Il y a] un rapport de confiance extrêmement fort. […] Il n’y a que quelques dizaines de milliers de Français à Berlin alors qu’il y en a des centaines de milliers à Londres. Comme il y a des Anglais en France. Il y a deux mégalopoles jumelles en Europe, qui sont Londres et Paris. Les dynamiques démographiques des deux pays sont les mêmes, proches de deux enfants par femme. » Et le démographe et historien français d’ajouter : « Le discours sur l’opposition entre l’Angleterre néolibérale et inégalitaire et sur la France de l’État social contient un élément de vérité, mais lorsque l’on observe ces deux pays, on voit qu’ils évoluent en parallèle, sur l’oppression des jeunes, les privilèges des vieux. Toutes les nations sont différentes, mais l’objectivité comparative doit nous faire admettre que le véritable monde étranger, [ce n’est] pas l’Angleterre. »
L’étude du géographe français Christophe Guilluy, publiée en 2010 sous le titre Fractures françaises, enrichit considérablement l’analyse du vote contre la Constitution européenne, et explique plus largement l’hostilité croissante du peuple français vis-à-vis des institutions de l'UE. Son ouvrage ne traite pas directement du rapport des Français à la question européenne, mais développe assez longuement la notion de « France périphérique », et décrypte le fossé qui sépare les catégories populaires à leurs élites. « L’évocation de leur réalité sociale et territoriale, explique Guilluy, permet d’apprécier les effets concrets des choix économiques et sociétaux des classes dominantes. »
Se voulant une démystification des rapports sociaux habituellement affichés dans les médias, opposant notamment les banlieues et les autres territoires, le livre de Christophe Guilluy jette ses bases sur un constat : de nombreuses familles assimilées à la « France d’en bas » ont progressivement fui la banlieue, l'image que les médias en renvoient, et ses problèmes d’insécurité, non pour rejoindre un centre-ville qu'elles n'ont pas les moyens d'habiter, mais pour le milieu périurbain, relativement déconnecté de la ville. Avec à la fois une désindustrialisation à marche forcée et des logiques foncières basées sur la gentrification, l'évolution des métropoles depuis la fin des années 1970 a clairement participé au départ des catégories populaires vers le périurbain. Alors que la ville industrielle les attirait, les accueillait, le modèle métropolitain contemporain les rejette violemment. Les catégories populaires sont désormais éloignées des centres de décision et des connexions de transport reliant les banlieues aux cœurs urbains. Quant à la classe politique, elle préfère se concentrer sur une « question des banlieues » caricaturée et dévoyée. Comme l'écrit Guilluy, « l’instrumentalisation politique des banlieues participe non seulement à l’échec des politiques publiques sur ces territoires, mais aussi à la difficulté d’établir un diagnostic à partir des dynamiques sociales démographiques qui traversent [les banlieues et le périurbain] depuis trente ans ».
« On le voit, si la disparition culturelle et politique des catégories populaires souligne la crise démocratique, elle permet surtout d’installer durablement l’image en trompe-l’œil d’une société apaisée, moyennisée et consensuelle. L’invisibilité des couches populaires évacue l’idée même de conflit. La conflictualité sociale et culturelle ne fait plus partie du champ politique ; c’est d’ailleurs une des principales causes de la désaffection d’une grande partie des électeurs pour les partis politiques. Cette société sans conflit permet d’entretenir efficacement le mythe d’une classe moyenne majoritaire et bénéficiaire de la mondialisation. » Ces quelques mots de Guilluy résument très bien le sentiment d’insécurité sociale et culturelle de cette « France périphérique », volontairement oubliée. Cette France qui a fait gagner le « non » en 2005. Le politologue Bernard Sananès l’expliquait lui-aussi le 8 octobre dernier dans l’émission C dans l’air, sur France 5 : « Il y a ce sentiment, et on l’avait vu évidemment dans les référendums européens, qu’il y a un clivage entre ceux qui subissent, ceux qui ne se sentent pas maîtres de leur destin, parce qu’ils considèrent que la mondialisation, la financiarisation, pèsent sur eux, et qu’ils en sont en quelque sorte des pions, et ceux qui ont le sentiment qu’ils sont armés dans la mondialisation, et qui peuvent être maîtres de leur destin. »
L'évolution du vote dans l'Hexagone entre le référendum de 1992 sur le traité de Maastricht et celui de 2005 sur le traité établissant une Constitution européenne. Les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) ne sont pas représentés, mais ont tous voté pour le « oui » lors des deux scrutins, à toujours plus de deux tiers des suffrages exprimés en 1992, et à toujours plus de 58% des voix en 2005. Une seule exception : La Réunion, qui avait voté « oui » à 74,24% des voix en 1992, a rejeté la Constitution européenne à hauteur de 60% en 2005.
Outre les milieux périurbains et ses populations « invisibles », on trouvait aussi dans cette France du « non » les territoires déclassés depuis les années 1980, notamment, comme le montrait déjà la carte du référendum à Maastricht, les zones désindustrialisées du nord de la France. Toujours dans Fractures françaises, Guilluy évoque justement « l’abandon de la classe ouvrière par les politiques », notant, depuis que les socialistes français ont épousé l’économie de marché, « une indifférence croissante pour la classe ouvrière en particulier et, plus massivement encore, pour les couches populaires des espaces périurbains et ruraux. […] La gauche sociétale et la droite libérale s’accordent dans une même volonté d’abandonner en douceur le modèle égalitaire républicain. […] L’ensemble des classes dirigeantes de droite et de gauche se retrouve ainsi sur une même ligne idéologique. » Or, ce sont bien les politiques menées depuis une trentaine d'années, mises en œuvre indifféremment par la droite et par la gauche, et dont les grandes lignes ont été tracées à Bruxelles (soit à la Commission, soit en Conseil des ministres), qui ont accentué les maux de ce pays, et qui ont été sanctionnées en 2005. Le processus s’est accentué depuis les années 1990. Rappelons que juste entre 2000 et 2007, 63% des destructions d’emplois industriels en France ont été le fait de la concurrence internationale, planifiée et encadrée par l’UE depuis l’Acte Unique. Une réalité qui n’est pas sans conséquence sur la géographie sociale de l’Hexagone, et donc, cela a été dit, sur la géographie du vote.
Dans les années 90, constatant l'existence de « deux France », Emmanuel Todd a analysé dans de nombreux écrits la carte du vote du « non » au traité de Maastricht en 1992, et son développement intellectuel peut à de nombreux égards enrichir la réflexion sur la question européenne, et plus généralement sur le devenir de notre démocratie sociale. Le clivage n'est plus, pour reprendre le mot du journaliste Éric Dupin, « d'une horizontalité idéologique », mais « d'une verticalité sociale », opposant la France d'en bas à celle d'en haut. Todd parle d'un « affrontement entre classes moyennes qui veulent se penser comme des élites, et classes populaires qui ne se sentent plus représentées par aucune doctrine ni aucun programme ». Il combat ainsi, comme Guilluy, la vision consensuelle de la structure sociale que porteraient les élites politiques et journalistiques, vision qui « empêcherait la représentation politique des conflits d'intérêts et de classes traversant la société française ». En un mot, l'illusion que tout va bien, dans le cadre de la construction européenne et de la « mondialisation heureuse ».
En Angleterre, ce sont aussi les « perdants » de la globalisation qui ont fait basculer le vote de juin dernier. Leur volonté étant de restaurer les pans de souveraineté que leur nation a progressivement perdus au profit de l’Union européenne, du secteur privé, de la finance (la fameuse City britannique), notamment depuis les années Thatcher (1979-1990). L’ambiguïté est là, et les « prescripteurs d’opinion » jouent allègrement là-dessus : ceux qui souhaitent rétablir un semblant de souveraineté à l’échelle étatique, ceux qui considèrent que la démocratie n’a de sens qu’à l’échelle nationale, c’est-à-dire l’échelle à laquelle les citoyens s’identifient le plus, ces gens-là, s’ils privilégient la nation à l’Europe, voire au monde, ne peuvent qu’être fermés, conservateurs, réactionnaires, anti-progressistes, fondamentalement mauvais, être dans l'erreur. Ranger l’adversaire dans une case (qu'il soit de droite ou de gauche, d'extrême-droite ou d'extrême-gauche), le caricaturer, a l’avantage de couper court au débat, puisque par principe ses propos seront tous irrecevables – en un mot, toute critique de l’Europe sera d'emblée déconsidérée, quelle qu’elle soit. Mais cette stratégie cache en fait assez mal la pauvreté des arguments pro-Union européenne. Et dans les faits, la construction idéologique opposant « mondialistes libéraux » et « nationalistes », ou pire, « humanistes » et « racistes », n’empêche plus les citoyens de voter comme bon leur semble. Cette dichotomie abusive sclérose le débat et accentue le fossé entre élites et catégories populaires. En bref, l'argument qui suppose que « l'Europe, c'est la paix et la fraternité entre les peuples » ne parle plus à grand monde, comme nous l'avions déjà vu dans cet article d'août 2015 : L'adage
Dans l’interview publiée le 3 juillet dernier, Emmanuel Todd allait dans le même sens : « Les Britanniques partent parce qu’ils n’aiment pas la bureaucratie bruxelloise, bien sûr, mais surtout parce qu’ils ont la liberté chevillée au corps. Ils perçoivent la zone euro […] comme le lieu d’une dérive antidémocratique. Et bien entendu, le retrait de l’Angleterre de l’espace européen central nous annonce dans un premier temps une accentuation de la dérive autoritaire de cette "Europa". » Il ajoute surtout que « la démocratie [...] ne peut, pour fonctionner, être que nationale ». Non par xénophobie ou par nationalisme, mais tout simplement parce qu’avant de se sentir « européens » ou « citoyens du monde », les gens se sentent nationaux. Les Français se sentent français, les Britanniques britanniques, les Italiens italiens, etc. Et il serait bien stupide de le leur reprocher. À cet égard, les postures telles que celle d'Emmanuelle Cosse, ancienne écologiste devenue ministre du Logement, qui souhaite la dissolution des États-nations dans une super-structure européenne (elle défendait cela le 9 décembre 2013 sur France 2), sont évidemment complètement décalées du ressenti du citoyen lambda. Une construction politique ne peut qu'échouer si elle ne se traduit pas par une amélioration concrète de la vie des gens, bien sûr, mais aussi si elle n'entraîne pas un sentiment d'appartenance, une certaine conscience collective, une volonté de bâtir un destin commun.
En France et au Royaume-Uni, ce sont donc essentiellement les zones déclassées qui ont voté contre l’UE, en 2005 comme en 2016. La construction européenne a participé au démantèlement des filets de protection étatiques qui préservaient les catégories socio-professionnelles les plus vulnérables des effets de la mondialisation. En ce sens, les orientations politiques et économiques adoptées par Theresa May depuis son accession au pouvoir, en prenant le contrepied de celles de Margaret Thatcher dans les années 1980, montrent que la nouvelle Première ministre britannique entend bien privilégier le choix de son peuple sur les menaces catastrophistes de la City et de ses homologues européens, qui promettent « un Brexit dur » (François Hollande, le 20 octobre dernier). « Dans la géographie électorale du Brexit, ce qui m’a frappé, disait encore Todd sur Atlantico.fr, ce n’est pas tellement le vote Remain de l’Écosse ou de Londres, attendus, mais l’abolition du clivage Nord-Sud qui semblait détruire l’Angleterre. L’Angleterre a voté Leave de façon homogène dans les régions conservatrices du Sud et dans les régions travaillistes du Nord. Un peu comme si le référendum avait déjà commencé à réunifier la société britannique. »
La carte électorale qui suit suffit à confirmer ce constat pour ce qui concerne le Royaume-Uni. Le référendum de 2005 en France montrait lui-aussi (Cf. carte précédente) une forte unanimité en défaveur du traité constitutionnel européen (alors que le vote sur Maastricht était plus partagé). On peut expliquer cela à la fois par la paupérisation des classes moyennes inférieures, et par leur rapprochement (spatial) avec les catégories populaires. Les discours pompeux sur la grandeur de la construction européenne ne suffisent plus à convaincre, et face à l'échec des politiques menées en France et en Europe depuis les années 80, la lassitude voire la colère a désormais gagné la majorité. Les ouvriers, employés, chômeurs, jeunes et retraités issus des milieux défavorisés, hier opposés, partagent à présent une perception commune des effets de la globalisation et de son corollaire urbain, la métropolisation. Le « non » de 2005, et les scrutins successifs qui sanctionnent constamment les gouvernements en place, représentent un cri de colère de ces catégories, qui rappellent qu’il faut encore compter avec elles. Cette France-là, populaire et égalitaire, n'a disparu que médiatiquement, et elle refuse de se plier au récit d’une « mondialisation heureuse » dont elle goûte depuis longtemps les fruits amers. Et Guilluy d'ajouter à ce sujet : « Désormais, seules les couches moyennes supérieures se disent majoritairement "plutôt à l’aise" financièrement : problème, ces catégories ne représentent que 15% de la population active ! Cet effondrement des classes moyennes est d’autant plus sensible qu’il intervient à un moment où le mouvement de réduction des inégalités, entamé au début du XXème siècle, est en train de s’inverser. »
Comme l'écrivait l'économiste Jean-Jacques Netter dans un article d'Atlantico.fr publié le 25 octobre dernier, la France « est coupée en trois : 1/ une France qui vit dans la mondialisation, qui accepte l'économie de marché et qui a confiance dans l'avenir. Toutes les enquêtes d'opinion se recoupent pour estimer que cela représente environ un tiers des Français. 2/ une France qui vit protégée par l'État à l'ombre de statuts particuliers, de subventions et d'allocations diverses. Ce qui représente à peu près 20 millions de Français. 3/ la France des exclus de tout qui compte désormais 25 millions de personnes est la honte du "modèle social que le monde nous envie" comme François Mitterrand et Jacques Chirac l'ont seriné pendant des années. » Si ces tendances, certes grossièrement dépeintes, ont un fond de vérité, il existe évidemment une grande diversité sociale dans les espaces ruraux, périurbains et industriels, dans cette « France des exclus de tout », et il serait possible de les analyser avec beaucoup plus de précision que ne le fera cet article. Les spécificités de chaque catégorie varient en fonction du niveau de développement local, de la distance qui sépare les individus de la ville, etc. Toutefois, on trouve bien, dans cette « France périphérique », la majorité des ouvriers et employés, souvent du secteur privé, des agriculteurs, mais aussi l’essentiel des retraités modestes, souvent précaires (essentiellement des anciens ouvriers et employés). Le monde paysan et les jeunes ruraux s'inscrivent sans aucun doute, précisons-le, plus que les autres dans cette pauvreté « invisible » décrite par Guilluy.
Problème, et c’est toute la difficulté d’aborder les comportements électoraux sans mépris, sans condescendance, mais aussi sans naïveté, le sentiment de déclassement social et de désaffiliation culturelle favorise l’attachement à des concepts identitaires simples et rassurants, dont le Front national se veut le héraut en France. Une telle posture explique que la campagne référendaire se soit, au Royaume-Uni, en partie concentrée sur la question migratoire. La gauche ayant abandonné les préoccupations des catégories populaires, celles-ci se rabattent sur un FN qui a su adopter une rhétorique chevènementiste, voire gaulliste, qui lui réussit électoralement. En milieu métropolitain, la « question sociale » est évacuée au profit de sujets de société où le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts excellent. Ce qui explique pourquoi ces deux partis font généralement des scores médiocres dès que l'on sort du cadre urbain.
La carte du vote de 2016 permet d'analyser le vote, région par région (carte de droite), mais aussi de manière plus fine (carte de gauche). Londres a voté à 59,9% en faveur du maintien, l'Écosse à 62%, et l'Irlande du Nord à 55,8%. Le Pays-de-Galles a voté à pour la sortie de l'Union, à 52,5%, et en Angleterre, sur les huit régions (hors Londres), toutes ont fait ce choix, et hormis le Sud-Est, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, toutes l'ont fait à hauteur de plus de 55% des voix, comme la carte de droite le montre bien. Le meilleur score du « Remain » s'est observé dans l'enclave de Gibraltar, où il a obtenu 95,9% des suffrages exprimés, puis dans le district de Lambeth, dans le sud du Grand Londres, avec 78,6%. Et le meilleur score du « Leave » dans le district de Boston (sur la côte Est, dans la région d'East Midlands), avec 75,6% des voix.
Un fossé entre le peuple et les élites, appelé à perdurer en France
Évidemment, comme déjà en 2005 avec la France et les Pays-Bas, la classe politique de centre-droit et de centre-gauche, à Londres comme à Bruxelles, a annoncé des catastrophes en série en cas de victoire du Leave. Déjà en janvier, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker annonçait, dans le cas d’un vote négatif des Néerlandais sur la ratification de l’accord d’association avec l’Ukraine, une « crise continentale ». Au lendemain du référendum au Royaume-Uni, il n’y avait qu’à se balader dans les réseaux sociaux pour croire que les Britanniques venaient de mettre fin à l’idée même de projet européen, voire à la paix et à la coexistence des peuples sur le continent. Pourtant, le danger n'est pas là. Si nos sociétés demeurent attachées à la paix et la prospérité que la construction européenne se targue d'avoir permises, la surdité de nos classes dirigeantes à l'égard des catégories populaires laisse place à des problèmes violents d'affirmation nationale, qui mettent en danger les principes d'entente et de coopération entre les peuples européens, voire parfois de ceux de tolérance, de solidarité et d'État de droit.
Les cris d’orfraie entendus dès le 24 juin pour s’interroger sur « la fin de l’Europe » ou « la fin du projet européen », se désolant des populismes divers qui se répandent sur le continent, laissent penser que, tout comme aux lendemains des référendums en France et aux Pays-Bas en 2005, en Irlande en 2008, ou encore en Grèce en 2015, les élites européennes n’ont toujours pas la bonne approche. En outre, elles se perdent dans un catastrophisme absurde et irrationnel, qui vaut bien le dogmatisme de beaucoup de partis nationalistes qui imputent systématiquement tous les maux de leur pays à l’Union européenne. Les dirigeants européens, notre classe politique, mais aussi de nombreuses voix dans les médias et dans les réseaux sociaux, déplorent le nationalisme, l’esprit de fermeture, ainsi que l’inaptitude, l’ignorance des peuples, le tout sur un ton élitiste fort méprisant. Dans les faits, on observe une montée inquiétante de la xénophobie, notamment en Europe de l’Est, en France, au Royaume-Uni et, plus étonnant au regard de l'histoire de ce pays, aux Pays-Bas. Mais dénoncer le racisme ou la bêtise des citoyens est une réponse un peu courte. Il est plus que temps de se questionner sur le fait qu’en France en 2005 comme au Royaume-Uni le 23 juin dernier, ce sont les régions déclassées, les catégories socio-professionnelles , qui ont fait basculer le vote contre l’Union européenne.
C’est peut-être entre autres parce qu’en France, les débats sur l'UE ne sont pas posés de façon sérieuse et convaincante, que le Front national continue de pointer en tête dans les sondages – rappelons que le FN a fait près de 28% des voix aux régionales de décembre 2015, et que les intentions de vote pour Marine Le Pen dépassent régulièrement la barre des 25% en vue de la présidentielle. Au Royaume-Uni au contraire, l’UKIP n’a totalisé que 12,65% des suffrages aux législatives de 2015 (et n'a obtenu qu'un siège à la Chambre basse), la promesse du Premier ministre sortant d’organiser un référendum relatif au « Brexit » ayant sans doute fait perdre des voix au parti europhobe, puisque dès lors, les questions relatives à l’Union européenne pouvaient trouver une issue avec à la clef le vote populaire. En France, aucune issue possible, aucune consultation envisagée par les élites politiques françaises pour sortir l’Hexagone de l’ornière communautaire ou pour proposer une réorientation des politiques européennes. Guilluy, « il est frappant de constater que la dégradation des conditions de vie et de travail des couches populaires et moyennes [n’a] pas débouché sur une contestation radicale ni sur des mouvements sociaux déstabilisateurs (les seuls mouvements d’ampleur sont ceux de la fonction publique, c’est-à-dire du socle d’une classe moyenne protégée des effets de la mondialisation ; ces mouvements – par définition intégrés à l’appareil d’État – ne cherchent pas à remettre en cause le système). » Nos hommes et femmes politiques semblent incapables de faire fructifier le comportement somme toute raisonnable de leurs concitoyens, et de
« Le référendum, c'est la démagogie et le populisme », « Le référendum est l'arme des régimes autoritaires », « Les électeurs ne répondent pas aux questions posées », « Les référendums blessent et divisent », « Le référendum est un élément perturbateur de la démocratie représentative », « Les peuples votent de façon émotive » : courant octobre 2016, alors qu'en pleine campagne pour la les promesses opportunistes de référendums se sont succédé, de nombreuses voix, de politologues, d'animateurs-télé, de chroniqueurs, et d'autres encore, se sont élevées dans les médias pour crier haro sur ce mode de consultation. La Suisse est pourtant là pour nous prouver que démocratie représentative et démocratie directe ne sont pas antinomiques. En outre, les critiques formulées à l'égard du référendum (dévoiement du vote, excès de démagogie, passion des débats...) pourraient être portées sur les élections : doit-on en déduire qu'il faut revenir sur la pratique des élections ? Au XIXème siècle, le même argumentaire était employé pour justifier le suffrage électoral censitaire. Le peuple est trop bête pour répondre aux questions posées, il ne comprend pas les enjeux, et ne répond qu'avec ses émotions, non avec sa raison. Pourtant, tout le monde se satisfait de l'avis du peuple lorsqu’il vote comme on le souhaite. Qui est venu se plaindre lorsque les Français ont approuvé (certes de peu) le traité de Maastricht en 1992 ? Lorsque les Portugais ont approuvé à 59,25% l’interruption volontaire de grossesse, en 2007 ? Ou lorsque le mariage homosexuel a été validé à 62,07% des voix en Irlande, en 2015 ? Ou encore quand les pays de l’Est ont successivement approuvé, courant 2003, leur entrée dans l’Union européenne ? Pourquoi se désoler de l’idée même d’avoir consulté les Britanniques ? L’Union européenne n'est-elle pas un rassemblement de nations qui souhaitent construire une communauté de destin ? En cela, aucune contrainte, et si un peuple désire quitter le navire, il vaut mieux en avoir connaissance et le laisser partir, plutôt que de refuser de le consulter, et voir ses frustrations et ses ressentiments croître.
Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof)déclarait assez justement, le 6 juillet 2015 sur France Culture : « Je ne dirai pas qu’on puisse parler du référendum en général, et dire : "Je suis pour le référendum" ou "contre le référendum". Rien à voir entre certaines votations en Suisse, qui se passent parfaitement bien, et l’exemple opposé qui est le référendum du 19 août 1934, où Hitler propose de fusionner, dans une ambiance de terreur, les fonctions de chancelier et de président. Voilà les deux extrêmes du référendum. » Doit-on rappeler que la démocratie a été restaurée au Chili à la faveur d’un référendum, celui de 1988, lorsque 55,99% des votants (pour un taux de participation de 97,53% des inscrits, tout de même !) ont rejeté une réforme constitutionnelle qui aurait prolongé la présidence du général Pinochet ? Le référendum permet de remettre le citoyen lambda au cœur du processus de décision, de se saisir de sujets importants et concrets, et tout simplement de s'exprimer. Les élites s’apercevant que le gouffre qui les sépare des catégories populaires s’accroît, elles crient au « populisme » et à la « démagogie » pour le rejeter par principe. Comme si les partis dits pro-européens, forts de leurs discours catastrophistes et de leur emphase creuse, ne faisaient eux-mêmes jamais preuve de démagogie dans les débats sur l’Europe.
S'agissant des référendums en France et au Royaume-Uni, la critique a posteriori du principe du référendum ne révèle pas seulement une lecture faussée du problème. Elle montre le creusement d'un fossé profond entre classes sociales. On veut éviter de consulter directement les catégories populaires et classes moyennes inférieures, bien qu'agrégées elles soient devenues majoritaires. Comme si la société se construisait mieux sans elles (voire contre elles) qu'avec elles.
Cet article s’inspirant largement de l’analyse de Christophe Guilluy sur la nouvelle géographie sociale de l’Hexagone, ces quelques mots extraits du chapitre 7 de son livre Fractures françaises, intitulé « Derrière la mondialisation heureuse », résume assez bien la question sociale actuelle, avec une mise en perspective historique :
La géographie sociale ne repose pas sur un paysage figé, elle se transforme au gré des mutations économiques et des évolutions sociodémographiques. La révolution industrielle et le développement de la classe ouvrière ont ainsi façonné le paysage social des XIXème et XXème siècle avec notamment les oppositions entre territoires industriels et ruraux, communes ouvrières et communes bourgeoises. La période des trente glorieuses, celle de la « moyennisation » de la société française, voit émerger une nouvelle géographie sociale, celle de la France pavillonnaire liée à l’émergence d’une classe moyenne majoritaire.
La période contemporaine accouche d’une géographie sociale singulière, liée d’une part à l’adaptation de la société française à l’économie mondialisée mais aussi à l’émergence d’une nouvelle structuration sociale. Sur les ruines de la classe moyenne majoritaire, on assiste en effet à une recomposition des catégories populaires et à leur redéploiement sur le territoire.
Cette recomposition sociale et économique est portée par la « métropolisation », c’est-à-dire la concentration dans les grandes villes des activités qui portent désormais l’économie française ; un modèle de développement qui n’intègre pas les classes populaires. Pour la première fois dans l’histoire, les classes populaires ne sont plus au cœur de la production des richesses. Si le marché de l’emploi métropolitain crée les conditions de la présence des cadres et, à la marge, des immigrés, il crée à l’inverse les conditions de l’éviction des plus modestes. Le résultat est imparable.
Ouvriers, employés, petits paysans, petits indépendants, retraités et jeunes de ces catégories vivent désormais à l’écart des « territoires qui comptent ». C’est une première. [Ces] catégories se répartissent dans une « France des fragilités sociales », à la périphérie des territoires les plus dynamiques, ceux des métropoles. Cette géographie sociale permet de souligner la place exacte conférée aux couches populaires à l’heure de la mondialisation : celle de « la périphérie ».

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)